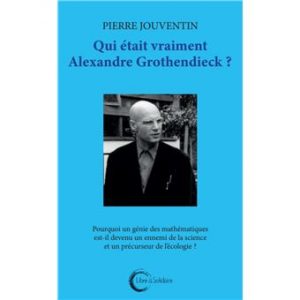Notre ami Pierre Jouventin, éco-éthologue, spécialiste des oiseaux et des mammifères répond à une une interview sur le site de « Reporterre ». Il y évoque l’acharnement des autorités à vouloir réguler les loups par des tirs, solution contre productive destinée à calmer et flatter éleveurs et chasseurs. Ceci contre l’avis des scientifiques qui, depuis longtemps, proposent des solutions alternatives …
Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....
.