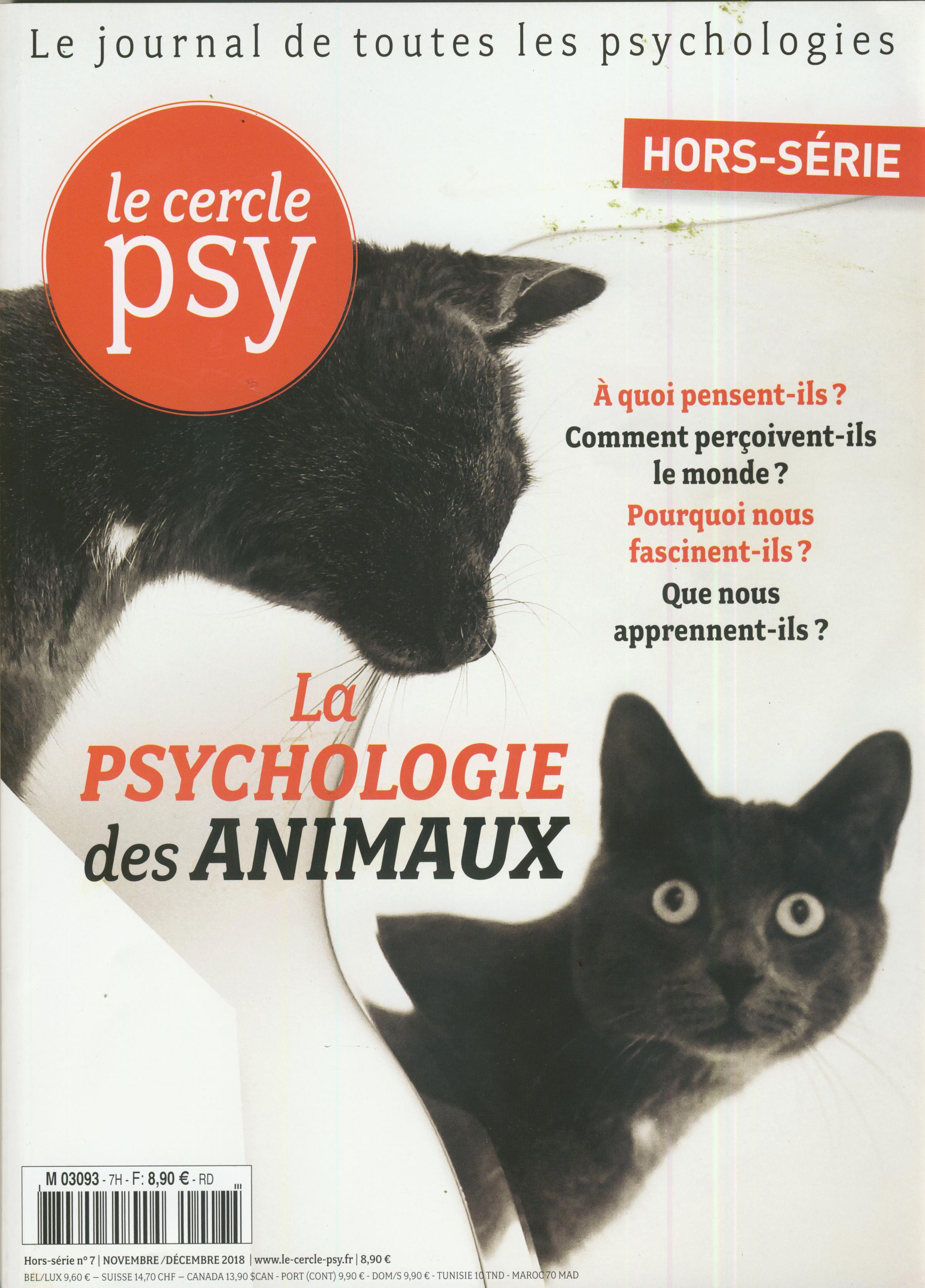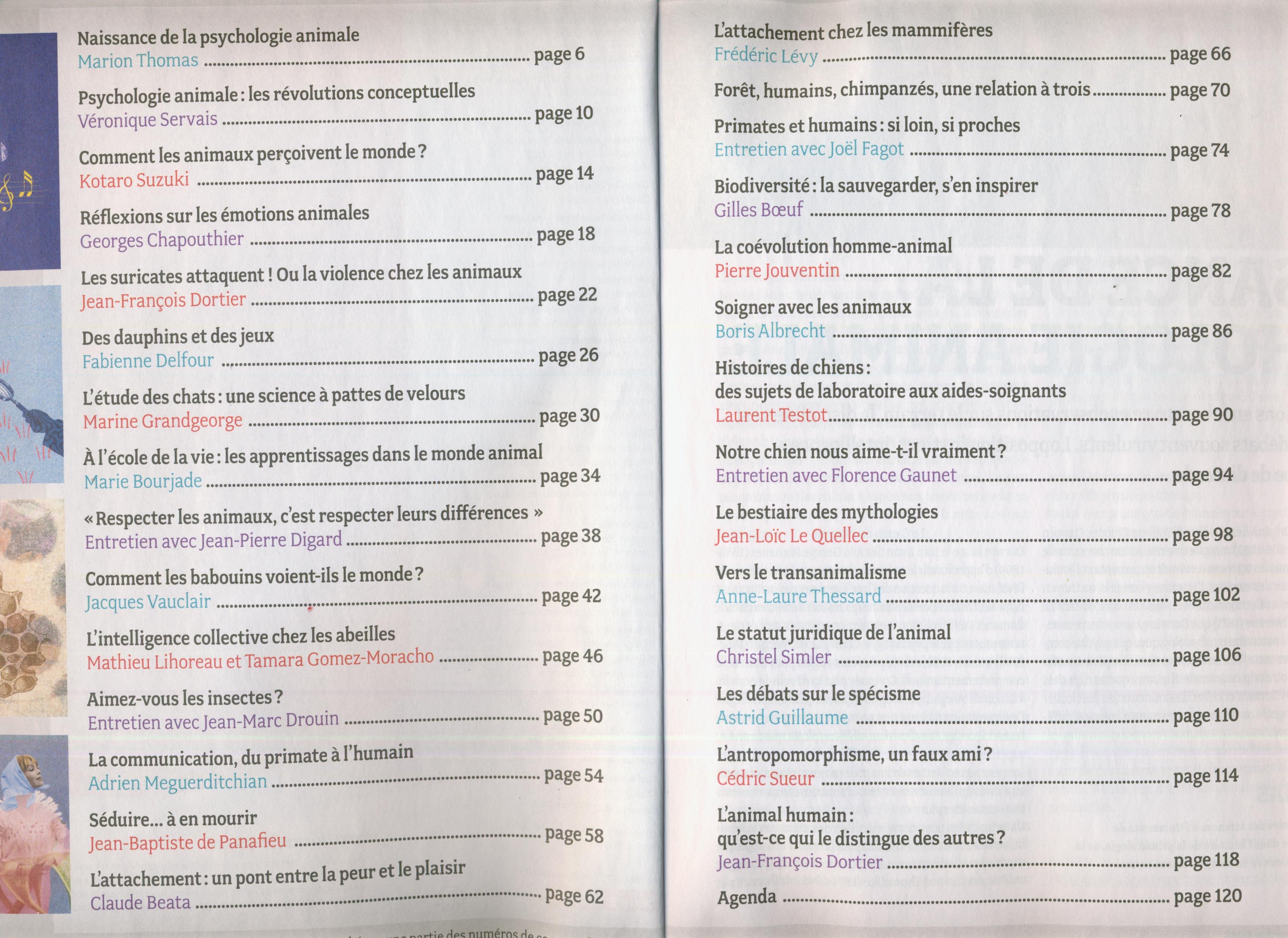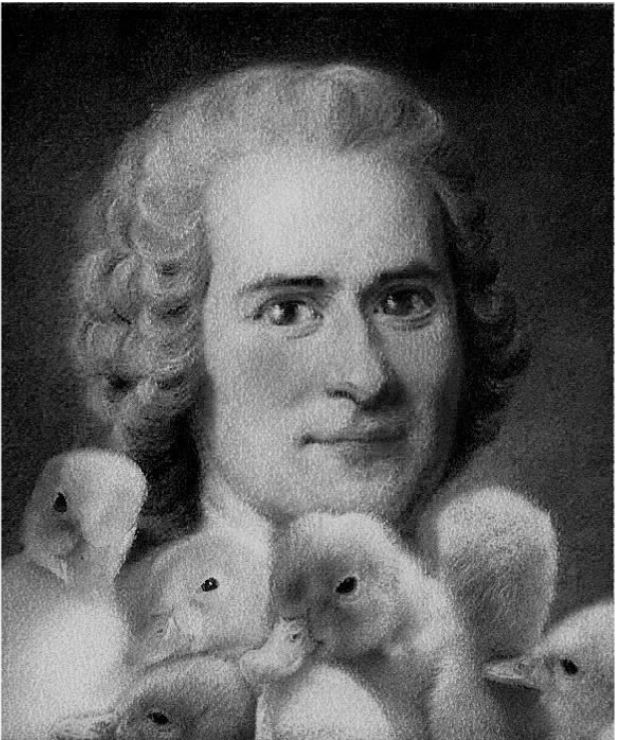Archives de catégorie: Animal/homme
Articles sur l’animalité de l’homme de Pierre
Comment l’éthologie a remis en question notre supériorité
Le débat sur ‘L’âme des bêtes’, qui a passionné tout le XVIIIe siècle, ne faisait quasiment pas allusion à la science, non pas que les penseurs de ce temps l’ignorent ou estiment que le débat est uniquement religieux. Tout au contraire, ils suivaient de près dans les salons l’actualité scientifique et les écrivains fréquentaient à cette époque les savants. Mais les questions débattues en biologie ne touchaient pas encore au comportement des animaux et l’éthologie -qui a pourtant été nécessairement le premier sujet d’étude de nos ancêtres chasseurs- a dû attendre le XXe siècle pour acquérir son autonomie.
L’étude scientifique du comportement animal avait en fait commencé un peu plus tôt, avec la psychologie expérimentale (Behaviourisme) qui visait à comparer par des tests en laboratoire les capacités intellectuelles des animaux à celles de l’homme. C’est justement par réaction contre cette vision scientiste que l’éthologie s’est cristallisée autour de l’étude d’espèces très différentes observées dans leur milieu naturel et dans des situations non artificielles. Auparavant, par souci de scientificité, quelques animaux étaient soumis à des batteries de tests qui devaient permettre de les situer sur une échelle en haut de laquelle se trouvait bien évidemment l’homme. Cela paraissait très rigoureux car tout était contrôlé, donc répétable[i] comme on le demande en science, mais c’était anthropocentré[ii], c’est-à-dire erroné sur le plan scientifique puisque que l’on posait à l’animal des problèmes humains. Ainsi le labyrinthe, qui correspond à une réalité pour une blatte ou une souris habituées aux recoins, ne signifie rien pour un léopard ou un singe qui ne les rencontrent jamais dans leur vie de tous les jours : leurs performances à l’issue de ce test seront nécessairement mauvaises alors que l’on croyait tenir une mesure objective de l’intelligence…
Il nous faut maintenant entrer dans un bourbier, un piège conceptuel créé par les ambiguïtés de notre culture occidentale et où les intellectuels français sont tombés. Les gens cultivés, qu’ils soient catholiques, existentialistes, capitalistes ou marxistes, considèrent en effet à la suite des philosophes grecs que l’homme est libre et ils en déduisent qu’il ne peut pas être déterminé génétiquement. L’homme serait donc un être purement raisonnable et l’animal un être totalement instinctif, ce qui est manifestement faux. Le biologiste du comportement sait bien que l’hérédité de certains traits psychologiques a été démontrée depuis longtemps et que le sujet dépasse la discussion de café du commerce, l’éthologie n’étant pas la physique et bien des comportements étant multifactoriels. Mais il n’ose en parler en sortant de son laboratoire car il n’aura pas le temps de s’expliquer et sera soumis au terrorisme intellectuel des humanistes à courte vue. Jacques Monod, le prix Nobel de médecine 1965, écrivait d’ailleurs il y a un demi-siècle : ‘Lorsque le comportement implique des éléments acquis par l’expérience, ils le sont selon un programme qui, lui, est inné, c’est-à-dire génétiquement déterminé’.
Comme l’éthologie a été précédée d’une tentative avortée (le behaviourisme), l’écologie comportementale a été, elle aussi, annoncée par une initiative malheureuse : la sociobiologie. Mais le débat a été suivi très superficiellement dans notre pays et plus qu’une méconnaissance qui serait facile à combler, il en est résulté un malentendu qui demeure. Du fait de leurs avancées considérables et récentes, les sciences de la vie sont en train de bouleverser la philosophie, la morale et le droit. Elles s’imposent par les nouvelles données qu’elles apportent et font ombrage de plus en plus aux sciences humaines qui voient cette incursion dans leur territoire d’un mauvais œil, d’autant plus qu’elles se sont « cristallisées à la fin du siècle dernier en réaction à ce qui était perçu comme une menace : l’hégémonie des sciences naturelles »[iii].
Se rendant compte qu’une science était en gestation à la rencontre de l’écologie, de l’éthologie et de l’évolution, Edward Wilson, célèbre professeur de Harvard et grand spécialiste des fourmis, en a fait une synthèse en 1975, se dépêchant de nommer cette nouvelle branche des sciences naturelles encore sans étiquette, ‘la sociobiologie’. Il n’était pas le premier à s’y intéresser mais pour que l’on parle de son livre de 700 pages qui n’est rien de plus qu’une excellente compilation des travaux de l’époque dans ce domaine nouveau, il a ajouté en début et fin de son gros ouvrage quelques lignes provocatrices annonçant la fin des sciences humaines qui, d’après lui, allaient être phagocytées par les sciences de la vie…
Sur ce chiffon rouge, les humanistes de tout poil ont foncé, tête baissée, pour empêcher cette tentative d’annexion de leur domaine et les sophistes ont profité de cette escarmouche pour régler son compte au biologisme.[iv] Quelques exemples caricaturaux comme le gène de l’homosexualité et le chromosome du crime ont été jetés en pâture pour prouver cette soi-disant forfaiture et ameuter le public cultivé imprégné d’humanités qui ne voulait pas voir l’homme réduit à l’état d’animal inférieur et génétiquement programmé… Le piège a donc bien fonctionné et le nom de sociobiologie a été connu du monde entier, mais, ainsi, le public, en particulier français, qui s’est fait une opinion sur des bribes et n’a entendu qu’un son de cloche, n’a pas eu le temps de s’informer et de réfléchir sur les nouvelles données.[v] Or la plupart sont indiscutables et éclairent d’un jour nouveau non seulement le comportement animal mais humain. Voici donc, très brièvement, comment on a pu escamoter un débat crucial mais surtout comment le piège tendu par Wilson pour faire parler de lui a été retourné contre la connaissance scientifique. Il est vrai aussi que l’opération de désinformation était facile tant le sens commun préfère les explications simplistes : dans ce monde idéal et inexact, les créationnistes ont raison et il n’y a pas d’évolution -surtout pas celle des comportements-, ni de pulsions innées chez les humains, tout étant culturel ; la Terre est plate, comme on le voit, et il n’y a pas de changement climatique dû à l’homme, comme le dit un académicien éminent, Claude Allégre…
Cette branche nouvelle des sciences de la vie n’en a pas moins continué à se développer depuis un demi-siècle. Evitant les disputes stériles et se démarquant de la sociobiologie, elle a pris le nom d’écologie comportementale. Elle est en pleine santé et représente aujourd’hui une communauté de plusieurs milliers de chercheurs, des centaines d’équipes ou de laboratoires dans le monde, une dizaine de revues spécialisées et chaque année des dizaines de congrès internationaux de plusieurs centaines ou milliers de participants.
Que peut-on extraire d’utile de cette controverse malheureuse qui a empêché le public cultivé, surtout dans notre pays, d’assimiler cette révolution conceptuelle ? D’une part, l’éternel problème de l’inné et de l’acquis a été tranché à la fin de la grande période de l’éthologie objectiviste et ce n’est pas rien : les biologistes du comportement sont maintenant d’accord sur le fait qu’aucun animal n’est purement instinctif car il comporte toujours une part d’apprentissage. Inversement, il n’y a pas d’animal purement raisonnable comme on conçoit encore souvent l’homme dans la culture occidentale et il existe dans la nature humaine un fond inné, ce qui parait évident quand on voit par exemple un bébé téter pour la première fois.
Pour expliquer cependant le fait que certains comportements dépendent de l’environnement comme l’avait avancé Lamarck sans pouvoir l’expliquer, une nouvelle science, l’épigénétique, a vu le jour depuis quelques années qui rend compte du fait que les caractères dépendent à la fois des gènes et du milieu. Les comportements, au même titre que les caractères morphologiques, ont une base innée mais nécessitent une expérience acquise pour s’exprimer plus ou moins, comme les notes de musique sont modulées par les indications du compositeur pour interpréter la partition (allegro, forte, etc.). Par exemple, la prédisposition au diabète est plus ou moins aggravée par notre régime alimentaire qui modifie l’expression des gènes : si vous mangez sainement, il peut ne pas apparaître mais si vous ingurgitez trop de graisses, il peut même se transmettre plus facilement à vos enfants… Il vient d’être montré par les chercheurs de l’université McGill que beaucoup de québécoises enceintes lors d’une mémorable tempête en janvier 1998 ont donné naissance à des enfants dont les globules blancs ont conservé dans leurs gènes la trace de ce stress. De même, la privation de nourriture ou le tabagisme des grand-mères pendant leur grossesse se répercuteraient sur le poids et la croissance de leurs petits-enfants… Dans une faible mesure, les caractères acquis seraient donc héritables : la génétique n’est donc plus en blanc et noir mais avec des nuances de gris ! Lamarck, qui parlait tant de l’influence du milieu sans expliquer comment il intervient, a été ainsi réhabilité, non pour l’opposer à Darwin mais pour le compléter.
Le classique dualisme inné/acquis est donc devenu obsolète en sciences du comportement car sans valeur opératoire, puisque tous les animaux -y compris l’homme- ne sont plus qu’un mélange inextricable des deux, en proportion variable d’une espèce à l’autre : l’insecte se trouve à un bout du continuum avec beaucoup d’inné et peu d’acquis et nous à l’autre bout avec l’inverse ! D’autre part, il existe bien une continuité globale entre toutes les espèces avec une complexification croissante des facultés cognitives. Mais dans le détail, chaque animal possède un type d’intelligence adapté à son environnement. Si nous décidons que le nôtre est supérieur, c’est un jugement de valeur qui n’engage que nous. En tout cas, il n’est pas scientifique d’affirmer, comme l’avait déjà dénoncé Darwin, que l’évolution est couronnée par l’espèce humaine qui règne sur les autres du fait de sa supériorité intellectuelle. Si on avait choisi comme critère les capacités olfactives, ce serait le chien !
Cette acceptation du gradient inné-acquis n’a pas été pour cela une décision autoritaire des ‘savants’ mais le résultat d’un consensus à l’issue d’études et de débats acharnés, comme toujours en science où aucune vérité n’est définitive. Pour répondre à la critique constructiviste et relativiste de ceux qui dénoncent la science qui ne refléterait que les opinions du moment et ferait autorité comme une nouvelle religion, citons le plus grand philosophe des sciences, Karl Popper : « L’histoire des sciences, comme celle de toutes les idées humaines, est une histoire de rêves irresponsables, d’entêtements, d’erreurs. Mais la science est une des très rares activités, peut-être la seule, où les erreurs sont systématiquement relevées et, avec le temps, assez souvent corrigées ».
[i] La répétabilité d’un phénomène rend aisée sa validation scientifique alors que l’impossibilité de le renouveler, comme c’est le cas pour l’évolution et le changement climatique, la complique, d’où les controverses.
[ii] Dans l’anthropocentrisme, l’homme occupe la place principale, puisqu’il est considéré comme le centre du monde au même titre que la Terre dans la cosmologie ancienne. Dans le biocentrisme, l’homme n’est qu’une espèce parmi les autres et ses capacités cognitives, qui sont les plus développées dans le règne animal, ne constituent qu’un trait marquant et non une supériorité.
[iii] Raymond Corbey in ‘La culture est-elle naturelle ? 1998, Errance.
[iv] Le plus virulent est André Pichot, historien des sciences au CNRS, qui a publié « La société pure, de Darwin à Hitler » (2001, Champs-Flammarion), et qui conclut ainsi une lettre ouverte sur la génétique du comportement parue dans ‘Le Monde’ du 25 juin 1998 sous le titre « Darwinisme, altruisme et radotage »: « S’agit-il de redorer le blason d’une discipline discréditée ? Pense-t-on vraiment que l’hérédité de l’altruisme et la biologie des bons sentiments seront mieux acceptées que le chromosome du crime et le gène de l’homosexualité ? Les premières sont certes plus ‘politiquement correctes’ que les seconds, mais elles sont tout aussi stupides et aussi peu scientifiques car, jusqu’à preuve du contraire, en génétique, l’hérédité s’arrête à la structure des protéines. ». Il faut avoir de l’aveuglement idéologique pour conclure sur une pareille contre-vérité…
[v] Pour se faire une idée plus exacte de la sociobiologie, lire ‘L’unicité du savoir. De la biologie à l’art, une même connaissance’ d’Edward Wilson (traduit en 2000 chez Laffont) et « La fourmi et le sociobiologiste » de Pierre Jaisson (Odile Jacob, 1992). Pour les données plus récentes concernant l’ensemble de l’éthologie, le livre d’Yves Christen ‘L’animal est-il une personne ?’ (Flammarion, 2009) comporte près de mille références et touche à autrement plus de domaines que ceux que j’ai pu évoquer ici.
Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous.....
Rousseau à l’épreuve des sciences
L’ancêtre des nazis (Introduction)
Rousseau n’a jamais fait l’unanimité, y compris parmi ses fidèles. « Il y a un Rousseau monarchiste ou feuillant, girondin à la mode Mme Roland, un Rousseau jacobin à la Robespierre, un Rousseau communiste à la Babeuf. Charlotte Corday, dévote de Jean- Jacques, n’en assassine pas moins Marat, autre admirateur. Il servira aussi la propagande des conservateurs, un discours réactionnaire mettant en valeur le ‟vraiˮ Rousseau trahi par la Révolution »1. Nietzsche parlait de « cet avorton qui s’est campé au seuil des temps nouveaux », Claude Lévi-Strauss le considérait comme son « frère ». Charles Maurras comme un « faux-prophète » et Bertrand Russell comme « l’ancêtre des nazis et des fascistes » ! Comment s’y retrouver avec cette inclassable idole des révolutionnaires de 1789 qui, elle, ne croyait pas en la Révolution, mais dont Robespierre écrivait : « Jean-Jacques restera toujours pour moi le plus grand homme que la France et l’humanité aient connu, et j’embrasse toutes ses œuvres, sans exception, du Contrat social aux Confessions » ? Il est vrai qu’il a inspiré tous les révolutionnaires du monde en s’interrogeant sur ce qu’était un gouvernement légitime, en critiquant ceux qui sont fondés sur l’arbitraire et la force. Mais un penseur aussi complexe peut être dénaturé : quand un Rousseau totalitaire est dépeint comme étant à l’origine de l’État absolu qui nie l’individu au profit du citoyen, on l’instrumentalise quelque peu et on nous incite à prendre le contre-pied, c’est-à-dire à choisir le modèle libéral…
Comment s’y retrouver avec ce paranoïaque et misanthrope, pourtant fondateur des sciences de l’homme, mais que Voltaire traitait d’« ennemi de la nature humaine » ? Emmanuel Kant, le considérait comme le « Newton du monde moral » et il est vrai que, sur des bases déistes, donc inverses de celles de Diderot, il a conçu, avec plus de persévérance que son ancien ami, un système complet d’explication de la nature humaine à partir d’un passé hypothétique de l’homme. Cela, avec pour tout moyen d’étude, l’introspection et l’observation de ses semblables. D’un côté, sa passion pour la botanique et donc son expérience de naturaliste, de l’autre, sa vie mouvementée et fertile en abandons, ont contribué à développer chez lui un don d’observation et d’analyse psychologique remarquable. Ses seules aides ont été la lecture des auteurs classiques et la fréquentation, un temps, des salons parisiens qui comptaient de brillants esprits. Ce contexte paraît bien dérisoire pour expliquer un projet aussi grandiose.
Depuis lors, les connaissances scientifiques se sont accumulées dans les domaines de la psychologie humaine (psychologie expérimentale, neurobiologie), du comportement animal (éthologie), des sociétés animales et humaines (sociologie, écologie comportementale, éthologie cognitive), des rapports entre l’homme – ou l’animal – et son milieu naturel (écologie scientifique, puis un siècle plus tard politique), du passé de l’homme et de la nature (préhistoire, archéologie, paléoanthropologie), de l’hérédité et de l’évolution (génétique des populations, biologie évolutive et moléculaire, paléontologie). Cette masse énorme de travaux pluridisciplinaires n’a plus rien à voir avec les balbutiements et les spéculations de l’époque des Lumières qui ignorait tout de l’origine animale de l’homme et de son passé. Comment les intuitions de Jean-Jacques résistent-t-elles, un quart de millénaire plus tard, à une confrontation avec les données scientifiques d’aujourd’hui ?
L’homme naturel (apport de l’éthologie objectiviste)
1 Raymond Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Tallandier, 2003, p.197.
Konrad Lorenz, le fondateur de l’éthologie que j’ai bien connu, critiquait violemment et à juste titre J.-J. Rousseau. Notre espèce est, en effet, sociale depuis son origine et il n’a jamais existé d’homme solitaire qui se soit associé ensuite avec d’autres pour créer une société… Le scénario imaginé par Rousseau dans Le contrat social est nécessaire pour fonder sa rhétorique mais il est invraisemblable pour un éthologiste. Un enfant ou n’importe quel mammifère juvénile ne peut se développer dans l’isolement social sans séquelles psychologiques graves. Cela a été démontré maintes fois et même expérimentalement dans les années soixante sur les macaques rhésus par Harry F. Harlow et son équipe.
Comment un esprit aussi perspicace que Jean-Jacques n’a-t-il pas compris cette évidence
de sociabilité de notre espèce ? Joseph de Maistre, autre théoricien de la nature humaine, se moquait de lui en avançant qu’il parlait en réalité moins de l’homme en général que de lui- même, génie solitaire et paranoïaque ! Cette explication décapante est plausible vu sa personnalité complexe et pathologique, mais Rousseau a des circonstances atténuantes. D’une part, les connaissances de l’époque en comportement animal étaient à peu près nulles, en particulier sur les primates, et d’autre part, bien que naturaliste, Jean-Jacques était féru de botanique et non de zoologie. En fait, Rousseau s’appuyait scientifiquement sur Buffon qui a participé activement à la naissance de la biologie mais qui parait aujourd’hui complétement dépassé.
L’étude du comportement animal et humain n’a pas un siècle. Il a fallu attendre la
deuxième guerre mondiale pour que des pionniers, en particulier Konrad Lorenz et Niko Tinbergeb – qui ont obtenu en 1973 le Prix Nobel – fondent l’éthologie qualifiée d’« objectiviste » par réaction contre la psychologie animale très subjective. Pour permettre la reproductibilité, le « behaviourisme » étudiait expérimentalement le comportement des animaux en captivité dans des boites de conditionnement opérant. L’individu était récompensé s’il donnait la bonne réponse, par exemple en appuyant sur une pédale. Le rat était le modèle des mammifères, le pigeon celui des oiseaux, la blatte celui des insectes. L’espèce, qui trouvait le plus vite la sortie du labyrinthe, était la plus intelligente… En réalité, le comportement d’un animal en captivité est biaisé ; il ne s’exprime pas pleinement, comme il l’aurait fait dans son milieu d’origine. En outre, un rat se débrouille mieux dans ces conditions artificielles qu’un léopard, sans que cela prouve sa supériorité intellectuelle. Tout simplement parce qu’il s’est adapté à ce milieu en deux dimensions au cours des millions d’années de son évolution alors que le léopard vit dans un espace en trois dimensions où il excelle : leur intelligence est différente. Enfin, ces deux espèces de mammifères sont opposées dans leur comportement social : le rat très sociable ne peut pas être pris pour modèle du léopard solitaire, pas plus que d’un autre mammifère comme l’éléphant ou la baleine. Bref, à se vouloir trop scientifiques, les behaviouristes ont été scientistes. Pour éviter l’anthropomorphisme en effectuant des expériences contrôlées en laboratoire, cette psychologie animale naissante reflétait la vision de ses auteurs qui guidait leurs recherches, sans même qu’ils s’en rendent compte. Dans leur paradigme anthropocentré, les animaux devaient être placés sur une échelle des êtres qui va des plus idiots aux plus malins, l’homme étant le « Roi de la Création », du fait de son intelligence et du verbe. D’une parenté généalogique, ces précurseurs déduisaient une hiérarchie des valeurs.
C’est le mérite des fondateurs de l’éthologie qui étaient à la fois naturalistes et zoologues,
d’avoir compris grâce à leur connaissance du terrain et de l’évolution des espèces que le
comportement de chaque animal a été modelé par le jeu de la sélection d’individus tous un peu différents les uns des autres. Cette hétérogénéité permet un tri par les conditions externes : celui qui est plus rapide échappe aux prédateurs, par exemple. Contrairement à ce que clament bien des philosophes, un animal a aussi une histoire non seulement personnelle, mais qui s’étend sur des millions d’années de sélection continue sur les traits héréditaires et qui porte sur l’inné plus que sur l’acquis de l’espèce. Seuls ont survécu et se sont reproduits les individus performants dans le contexte – qui peut changer, en particulier climatiquement – et qui a abouti de génération en génération à une adaptation morphologique, physiologique et comportementale parfaite à la niche écologique. Le léopard (ou le chat avant la domestication) est remarquablement bien adapté à la chasse nocturne à l’affut et à la prédation dans les arbres, mais, dans le même milieu forestier, un rat est aussi très bien adapté à sa vie au sol, donc différemment et pas mieux. Pour en revenir à l’homme solitaire, Rousseau, d’après Lorenz, se serait lourdement trompé sur cette sociabilité de notre espèce qui serait secondaire et la science moderne du comportement aurait corrigé cette grossière erreur. En réalité, comme nous le verrons en conclusion, ce débat repose sur un malentendu, Rousseau étant souvent plus complexe que ses lecteurs ne l’imaginent, d’où des débats passionnés.
Cette critique est d’autant plus dommageable que Jean-Jacques est connu pour son amour des animaux, en particulier de son « chien bien-aimé » et de sa « vieille chatte » qu’il considérait comme des compagnons, ce qui témoignait d’après Diderot de son mépris des hommes… Lorenz, qui était à ses heures perdues philosophe, et Rousseau, qui était aussi naturaliste, avaient donc la même approche – par l’intérieur – du comportement. Les deux pratiquaient l’étude de l’autre par identification (on dirait aujourd’hui par empathie), Lorenz allant, par réaction contre ses prédécesseurs scientistes, jusqu’à revendiquer la nécessité de « tomber amoureux » (falling in love)2 de son sujet d’étude non humain pour mieux le comprendre. Les deux comparaient l’homme et les animaux afin de montrer, pour Lorenz, les bases biologiques de la nature humaine et, pour Rousseau, son origine divine.
Éthologue avant l’heure, Rousseau se demande ce qu’est l’instinct, pourquoi la bête « faitle bien » sans raisonner. Observant le comportement de chasse de son chien qui tue les taupes sans les manger, il comprend que ces pulsions sont innées et distinctes3. Ce sont des instincts qu’il attribue à Dieu, comme la bonté humaine qui est, pour lui, naturelle et instinctive. Sans connaître ce texte de Jean-Jacques, Lorenz lui répond : « Nous savons de nos chiens qu’ils exécutent avec passion le mouvement de flairer, lever, courir, traquer, happer et secouer à mort une proie imaginaire, sans avoir faim. Les amis des chiens n’ignorent pas non plus que même en le nourrissant aussi bien que possible, on ne peut malheureusement pas guérir de sa passion un chien acquis au plaisir de la chasse »4. Même dialogue involontaire et, à travers le temps, sur la parade nuptiale innée de la colombe (Rousseau) et d’un poisson (Lorenz). Devant un chien, qui se roule au pied de son maître qui le gronde, Rousseau se pose le problème de la conscience qui « ne se trompe jamais » à la différence de la raison et qui « est à l’âme ce que l’instinct est au corps »5. Il s’interroge sur l’amour maternel que l’on observe chez notre espèce comme chez les autres, sur la pitié que nous avons pour un jeune chien qui fait des bêtises et qui nous empêche de le battre. Pourquoi le chien adulte ne peut-il attaquer le chiot (qui peut être, pourtant, comme le note Lorenz, plus gros que lui dans certaines races) alors que quelques hommes peuvent le faire souffrir en y prenant plaisir ? Rousseau répond que c’est la civilisation qui l’a corrompu et Lorenz, après Schopenhauer, que l’homme s’est autodomestiqué, les animaux domestiques étant moins soumis aux déclencheurs innés…
Nous en venons à ce que l’on nomme de nos jours « le droit des animaux » et que le philosophe Peter Singer appelle, dans le titre d’un livre vendu à plus d’un million d’exemplaires, La libération animale, puisqu’il la considère comme la suite logique de la lutte pour les droits des noirs, des esclaves et des femmes. Descartes, qui possédait lui aussi un
2 Konrad Lorenz, Studies in animal and human behaviour, London, Methuen, 1970, vol.1, p.16.
3 J.-J. Rousseau, Émile ou de l’éducation, livre IV dans Édition thématique du Tricentenaire–Œuvres complètes, éditée par Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger. Paris, Genève, Champion, Slatkine, 2012, t. VIII, p.
711-712. Référence abrégée ET-OC par la suite.
4 Konrad Lorenz, L’Agression, Paris, Flammarion, 1969,
5 Émile ou de l’éducation, livre IV, ET-OC VIII, p. 711.
chien, a conçu la théorie de l’animal-machine qui nie toute intelligence à ceux qualifiés par nous de « bêtes ». Cette thèse, qui a beaucoup influencé les intellectuels de notre pays jusqu’à récemment mais que la science moderne a complétement rejetée, avait fait bondir certains des contemporains de Descartes comme Jean de La Fontaine (qui était Maître des Eaux et Forêts), Charles-Georges Leroy (Lieutenant des chasses royales, encyclopédiste et précurseur de l’éthologie), Condillac et David Hume. Passe encore qu’on refuse aux animaux une âme dont rien ne dit qu’elle existe, mais comment peut-on affirmer sérieusement qu’ils ne sentent rien et ne pensent pas parce qu’ils ne parlent pas ? Rappelons l’anecdote de Fontenelle rendant visite à Malebranche, disciple de Descartes, qui donne un coup de pied à sa chienne prête à mettre bas. À la critique du visiteur, le prêtre oratorien répond : « Ne savez-vous pas qu’elle ne sent rien ? ». À l’opposé de Diderot, cette empathie pour l’animal est, pour moi, un plus, un indice que Rousseau peut aussi être considéré comme un précurseur discret de l’éthologie et de la cause animale.
L’homme sauvage (apport de l’écologie comportementale)
Dans le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, Rousseau est un précurseur évident de l’ethnologie puisqu’il nous compare avec les autres sociétés humaines, en particulier les « primitifs » (ou, moins péjorativement, les « peuples premiers »). Il est aussi un précurseur de la paléoanthropologie quand il nous compare aux autres primates qui, éduqués, pourraient peut-être selon lui devenir humains… Il se demande si les grands singes, aujourd’hui scientifiquement nos cousins, sont des animaux ou bien « de véritables hommes sauvages » qui n’ont pas pu développer leurs facultés intellectuelles6. Ces interrogations paraissent bien naïves sans doute, après que les primatologues et psychologues animaliers de la deuxième moitié du XXe siècle eussent appris aux grands singes le langage des signes et que certains de leurs élèves simiesques eussent ensuite enseigné à leurs petits les rudiments de ce langage gestuel typiquement humain.
De la même génération que Rousseau, Linné est l’inventeur de la classification binominale des êtres vivants que nous utilisons toujours pour les noms scientifiques comme Homo sapiens. Il écrivait en 1793 dans le Système de la nature : « L’HOMME, doué de sagesse, le plus parfait ouvrage de la Création, et son dernier et principal objet, portant en lui des indices étonnants de la Divinité, habite la surface de la terre ; il juge d’après l’impulsion des sens du mécanisme de la nature, il est capable d’en admirer la beauté, et doit au Créateur son juste tribut d’adoration ». Ce croyant sincère, dont on ne peut mettre en doute la foi, se lamentait en
1735 en ces termes : « Je ne vois aucune différence qui me permette de distinguer l’homme
des grands singes au point d’en faire des genres différents. J’aimerais bien qu’on m’en indique une ! ». Il prouve par là son honnêteté intellectuelle et sa compétence, puisque certains biologistes d’aujourd’hui réclament que les genres Homo – les humains – et Pan – les chimpanzés – soient confondus vu la faible distance génétique qui les sépare. Bien postérieur à Descartes et à sa thèse – incroyable au sens littéral – de l’animal-machine, Rousseau s’interroge, avec le peu d’informations disponibles à son époque, sur le statut des « hommes sauvages » et des « animaux dénaturés » : sont-ils des humains, des singes ou des chimères ? Les animaux dénaturés est aussi le titre d’un roman de Vercors qui, comme Claude Lévi- Strauss, s’est intéressé après la seconde guerre mondiale au statut d’« humain ». En effet, les nazis avaient déplacé la frontière entre l’homme et l’animal pour inclure dans la deuxième catégorie les juifs, les noirs, les tziganes ou les homosexuels que l’on a donc abattus comme des bêtes. Comme le résume Vercors dans son roman : « Tous nos malheurs proviennent de ce que les hommes ne savent pas ce qu’ils sont, et ne s’accordent pas sur ce qu’ils veulent
6 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, ET-OC V, p. 201.
être… Mais alors, s’écria Doug, où passe la ligne de démarcation ? Le Pasteur hocha la tête, et, fermant les yeux, murmura : S’il parle, baptisez-le, mais s’il ne parle pas, cuisinez-le ». Il s’agit donc d’une variante de la controverse de Valladolid qui, en 1550, portait sur le statut des Amérindiens que les Espagnols mettaient en esclavage pour exploiter le nouveau continent alors que, d’après le dominicain Bartolomé de Las Casas, ils étaient aussi des
« enfants de Dieu », synonyme pour lui d’humains.
Rousseau compare ainsi l’homme à l’animal plus sérieusement que les philosophes
anthropocentrés qui cherchent, parfois avec mauvaise foi, à valoriser leur espèce. Martin Heidegger résumait en 1930 cette thèse classique : « La pierre est sans monde, l’animal est pauvre en monde, l’homme est configurateur de monde »7. Perspicace dans son analyse et prolongeant la pensée de Buffon, Rousseau note la faiblesse en « instinct propre » de l’homme et donc sa « perfectibilité »8. Cette incomplétude, comme on la nomme aujourd’hui, constitue pour beaucoup de philosophes comme Kant, Fichte et même des biologistes comme K. Lorenz, S.J. Gould, A. Prochiantz, J-D Vincent9, la preuve de notre libre-arbitre. Luc Ferry reprend même le concept de Nietzsche10 d’une « faculté d’anti-nature » propre aux humains11. C’est ainsi, en creux, le problème majeur du « propre de l’homme » que Rousseau aborde si intelligemment que son approche reste privilégiée aujourd’hui pour différencier l’homme des autres espèces. C’est d’autant plus remarquable que les sciences du comportement animal ont, en un demi-siècle, réduit considérablement ce « propre de l’homme ». Personne ne soutient plus que les animaux ne pensent pas et n’ont pas d’intelligence. Même la raison, l’intelligence, l’abstraction existent chez bien des espèces à un moindre niveau que chez l’homme : après l’avoir trouvé chez les autres mammifères, on l’a découvert chez des oiseaux et récemment chez des mollusques comme les poulpes. La thèse, qui émerge peu à peu à notre époque, est celle de Darwin, c’est-à-dire d’une différence de degré et non de nature entre les capacités intellectuelles de l’homme et celles des autres vertébrés. Même les capacités considérées comme les plus élevées comme la sociabilité, l’entraide, l’empathie et l’altruisme sont maintenant reconnues dans le règne animal12. Les cultures animales (ou « protocultures » car elles sont plus simples) sont aujourd’hui admises alors que jusqu’aux années soixante-dix, à l’époque où les chercheurs japonais ont décrit les apprentissages sociaux réalisés par les macaques dans la nature, on n’osait pas en parler ailleurs que chez l’homme. Les chercheurs internationaux, les plus reconnus actuellement dans ce domaine comme Frans de Waal, décrivent même chez les singes des embryons de morale et de politique13. Surtout, on sait par les débats des années soixante-dix en éthologie que l’inné et l’acquis ne s’opposent pas et coexistent chez toutes les espèces, intriqués mais en proportion variable : si les insectes ont beaucoup d’instincts et peu de comportements appris, les mammifères présentent la proportion inverse. Les primates et surtout l’homme restent les grands spécialistes du culturel, comme l’avait compris Jean-Jacques. « Pour Descartes, Buffon, Rousseau, Kant, et bien d’autres, l’homme tire paradoxalement sa supériorité du fait qu’il lui manque quelque chose », tranche plaisamment Yves Christen14. Rousseau n’est pas le premier à énoncer cette idée forte mais il a eu l’originalité de la développer et même d’en voir les inconvénients en essayant
7 Martin Heidegger, Les concepts fondamentaux de la métaphysique, Paris, Gallimard, 1992.
8 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, ET-OC V, p. 111.
9 Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, Qu’est-ce que l’homme ?, Paris, Odile Jacob, 2001, p.144.
10 « La morale, une anti-nature » est le titre en français de l’un des chapitres du Crépuscule des idoles de
Friedrich Nietzsche (dans Œuvres philosophiques complètes VIII, Paris, Gallimard, 1974, p. 82).
11 Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique, Paris, Grasset, 1992, p.103.
12 Frans de Waal : L’âge de l’empathie, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2010 et Le bonobo, Dieu et nous traduit en
2013 chez le même éditeur.
13 Frans de Waal, La politique du chimpanzé, Paris, Odile Jacob, 1995.
14 Yves Christen, L’animal est-il une personne ?, Paris, Flammarion, 2009, p. 377-378.
d’en préciser la cause : si le comportement humain est malléable, ses bases sont fragiles, et il
peut dériver vers des excès lorsque la civilisation les exacerbe…
Buffon comme Rousseau expliquent la Création par une force surnaturelle. La perfection
du monde vivant a longtemps constitué l’argument principal des croyants (la providence divine) jusqu’au darwinisme qui en a découvert le mécanisme (sélection naturelle des caractères héréditaires). Dans Les époques de la nature (1778), le mentor scientifique de Jean- Jacques parle des premiers hommes « à l’état de pure nature », expression qu’il lui a empruntée15 et qui n’a pas le sens politique donné par Hobbes ou Montesquieu. À l’époque de Buffon, on ignore l’évolution des espèces – donc nos racines animales – et même nos ancêtres humains puisque son contemporain, Cuvier, pourtant le fondateur de la paléontologie, nie l’existence d’hommes fossiles. On sait aujourd’hui que notre histoire est bien plus longue qu’on l’imaginait à cette époque et, depuis peu, nous en avons la preuve par la biologie moléculaire. En datant l’ADN, on sait qu’il y a 40.000 ans vivaient sur terre, outre Homo sapiens, bien d’autres hommes : Néandertal, Denisova, Solo, etc.16 Ce n’est donc pas une lignée animale aboutissant linéairement et progressivement à l’homme, comme la Bible, Descartes ou Comte l’expliquaient mais plutôt un buissonnement d’espèces de primates dont toutes les branches humaines sont mortes sauf une, la nôtre. Jean-Jacques et Diderot seraient surpris de l’apprendre. Encore plus Voltaire, qui doutait de l’évolution des espèces au point d’écrire : « Cela est fort beau ; mais j’ai de la peine à croire que je descende d’une morue ».
Un malentendu majeur et bien postérieur à Rousseau a brouillé la compréhension des enjeux sur la nature humaine. Charles Darwin a longtemps été confondu, et jusqu’à récemment dans notre pays, avec le darwinisme social. Si l’évolution des espèces, reste la seule explication scientifique de la biodiversité et de l’origine de l’homme, son interprétation comme loi du plus fort et comme justification du capitalisme est évidemment idéologique. Présenté à droite comme le théoricien du capitalisme justifiant la compétition sociale, et à gauche comme un bourgeois capitaliste, Darwin n’aurait fait, selon Marx, que transposer dans la nature la société victorienne compétitive. En réalité, Darwin a pris ses distances avec cette dérive politico-sociale dans le livre17 qui a suivi son maître ouvrage, L’origine des espèces, mais qui a été peu lu. Le néodarwinisme intégrant maintenant la génétique moderne repose en grande partie sur la compétition, l’hérédité et la sélection naturelle, mais il ne cautionne absolument pas les dérives capitalistes, communistes, nazis et autres qui ont tenté de l’instrumentaliser pour se donner une apparence et une justification scientifiques, ainsi que je l’ai analysé ailleurs18.
Marx et Engels ont apprécié que le darwinisme permette d’expliquer la genèse du monde vivant et de l’homme sans faire appel à Dieu, mais ces socialistes ne cautionnaient évidemment pas ce qu’ils nommaient « la lutte de tous contre tous ». C’est un autre communiste mais anarchiste, Pierre Kropotkine, qui, au lieu de nier Darwin et le darwinisme, compléta son tableau fondé sur la compétition par une force de l’évolution sociale tout aussi fréquente dans la nature mais moins visible, la coopération19. Un demi-siècle plus tard, le biologiste William Hamilton démontra mathématiquement comment l’altruisme pouvait se transmettre aux descendants, ce qui paraissait impossible jusqu’alors, mais qui a permis
15 Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau, Paris, Vrin, 1983, p.
298.
16 Le paléoanthropologue Pascal Picq a décrit ces découvertes récentes sur le passé de l’homme dans de
nombreux livres de vulgarisation.
17 Charles Darwin, La filiation de l’homme, Paris, Champion, 1871. http://darwin-online.org.uk/
converted/pdf/1891_DescentFrench_F1062.pdf
18 Pierre Jouventin, La face cachée de Darwin. L’animalité de l’homme, Paris, Libre & Solidaire, 2014.
19 Pierre Kropotkine, L’entraide, un facteur de l’évolution, 1902, réédité par les éditions Écosociété, collection
Retrouvailles, 2005.
d’expliquer génétiquement l’apparition des sociétés supérieures d’insectes (fourmis, abeilles,
termites) où tous se sacrifient pour la collectivité.
Vers 1975, l’éthologie a, elle aussi, dû intégrer les avancées de la génétique des
populations. Il ne s’agissait plus d’individus pris dans une perspective écologique comme précédemment, mais de groupes sociaux considérés dans une perspective évolutionniste donc historique. Bien des biologistes ont pris ce tournant majeur à cette époque mais celui qui a fait le plus parler de lui est E.O. Wilson, un entomologiste américain qui est à l’origine de deux mots aux destins contraires : biodiversité et sociobiologie. Si le premier est passé dans le langage courant, le second est devenu tabou du fait des polémiques et des malentendus qu’il a créés. En effet, cette rencontre entre la biologie et la sociologie a provoqué une levée de boucliers chez les chercheurs en sciences humaines et les militants de gauche qui accusèrent Wilson (comme auparavant Darwin) de biologiser l’homme en justifiant ainsi le racisme, le sexisme, le militarisme, le capitalisme, le fascisme, etc… C’était bien trop lui prêter mais, pour éviter ce malentendu, on préfère parler aujourd’hui d’écologie comportementale (Behavioural ecology) pour nommer ce champ de connaissance au croisement de l’éthologie, de l’écologie et de l’évolution. Cette nouvelle discipline scientifique se porte fort bien et prétend aussi traiter de l’homme soumis comme les autres espèces à la biologie, donc moins libre que Rousseau et ses successeurs le décrivent.
Le bon sauvage (apport de l’éthologie cognitive)
Le point principal de dissension entre Rousseau et les autres philosophes est peut -être le mythe du bon sauvage qui suppose l’existence d’une nature humaine, alors que la plupart des philosophies la nient, comme par exemple Sartre dans L’existentialisme est un humanisme. Pour ce dernier, la liberté nous distingue des animaux, alors que pour Jean-Jacques, ce qu’il nomme la perfectibilité fait partie de notre nature. Dans Émile, Rousseau écrit : « Il est donc au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes, nous jugeons nos actions et celles d’autrui comme bonnes ou mauvaises »20. L’homme est-il bon par nature comme il le décrivait ou mauvais et ne devenant bon qu’en sortant de la condition animale, comme le peignait Emmanuel Kant après avoir lu ces lignes21 ? Joseph de Maistre, qui tenait Jean-Jacques pour « l’homme du monde peut-être qui s’est le plus trompé », écrivait dans son pamphlet L’état de nature : « Puisque l’homme est mauvais, il faut qu’il soit gouverné ; il faut que, lorsque plusieurs veulent la même chose, un pouvoir supérieur à tous les prétendants adjuge la chose et les empêche de se battre : donc il faut un souverain et des lois […] ; un être social et mauvais doit être sous le joug ».
L’irréductible Jean-Jacques a donc longtemps été considéré comme un grand naïf car il était en désaccord total avec les réalistes-cyniques comme Voltaire, puis avec le darwinisme social. Cette vision de la société, héritière de Thomas Hobbes qui clamait que l’homme est un loup pour l’homme22 et préconisait la loi du plus fort, n’est pas révolue. Elle est même plus que jamais présente en économie et en politique, mais il est vrai que les arguments de Rousseau paraissaient d’autorité et donc étaient tenus pour faibles : « Je vous dirais que je le sais parce que je le sens […]. C’est en vain qu’on voudrait raisonner pour détruire en moi ce sentiment, il est plus fort que toute évidence »23.
Mais cette bonté naturelle de l’homme, qui a paru longtemps naïve et erronée, se voit validée de plus en plus par la neurobiologie chez bien des espèces et décrite dans les sciences
20 Émile ou de l’éducation, livre IV, ET-OC VIII, p. 715.
21 Emmanuel Kant, Traité de pédagogie, Paris, Alcan, 1886.
22 Reprenant la formule de Plaute : Homo homini lupus.
23 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l’éducation, livre IV, ET-OC VIII, p. 686.
du comportement animal sous la forme de l’entraide24. Le dernier demi-siècle a en effet apporté une moisson considérable d’observations de coopérations et de cultures animales dans des centaines d’espèces. Les chimpanzés, par exemple, possèdent des traditions qu’ils se transmettent de génération en génération et qui varient d’un groupe social à l’autre : pour casser les noix, pour traquer et se partager des petits singes, pour attraper des termites, pour éponger de l’eau, pour se soigner par les plantes médicinales, pour se saluer quand ils se rencontrent, etc. La fabrication d’outils a été observée chez bien des mammifères et même des oiseaux, par exemple la corneille de Nouvelle Calédonie, est capable de casser une ronce pour extraire les vers du bois (et de la cacher pour la retrouver) ou, en captivité, de plier un fil de fer pour remonter avec ce crochet un panier rempli de fruits. Le sens de l’esthétique est présent chez les oiseaux-jardiniers qui décorent, avec des fruits colorés dans la même teinte, leur arène de parade nuptiale ou peuvent en peindre l’intérieur en broyant des fruits. La biologie de l’altruisme est aujourd’hui étudiée dans des dizaines de laboratoires universitaires et sur des espèces très différentes allant des primates aux fourmis. Même les facultés intellectuelles supérieures comme l’abstraction, qui paraissaient le pré carré de l’homme, ont été découvertes dans les années quarante chez les abeilles – dont le cerveau est de la taille d’une tête d’épingle – qui indiquent par leurs danses à leurs congénères, dans l’obscurité de la ruche et sur un plan vertical, la direction par rapport au soleil et la distance où se trouvent les fleurs. Plus doués que les humains, les chimpanzés sont capables de suivre sur un écran d’ordinateur les chiffres qui apparaissent puis s’éteignent aussitôt, puis de répéter le défilement en touchant du doigt l’écran dans l’ordre d’apparition, alors que nous sommes très loin d’en être capables à cette vitesse. Il est impossible de tout passer en revue ici mais le plus complet des livres de vulgarisation bien référencés sur les recherches actuelles en comportement animal me parait celui d’Yves Christen : L’animal est-il une personne ?25
Cette réhabilitation de l’existence de facultés supérieures chez les animaux est à l’origine d’une branche appelée l’éthologie cognitive, qui considère qu’il ne faut pas craindre ni de parler d’intelligence animale ni de ses bases biologiques. Donald Griffin, le découvreur du sonar des chauves-souris, est l’initiateur de cette proposition26. Par réaction contre la théorie cartésienne de l’animal-machine, ce chercheur parle même de « conscience animale », ce qui paraît beaucoup dans la mesure où l’on ne sait pas définir scientifiquement la conscience qui est polysémique. L’anthropologue Tim Ingold répliquait d’ailleurs : « Griffin veut rendre les animaux rationnels, alors qu’on sait très bien que l’homme ne l’est pas »27. Plusieurs livres de vulgarisation de Franz de Waal, primatologue, psychologue et représentant le plus connu de cette discipline, ont été traduits dans notre langue28. Cette nouvelle branche de l’éthologie est très active et vise ouvertement à comparer l’homme aux autres espèces, comme tentait de le faire Rousseau avec les rares données disponibles à son époque.
24 Titre du livre fondateur de Kropotkine (réédition en 2005 de L’Entraide : Un facteur de l’évolution, chez les éditions Écosociété-Collection Retrouvailles).
25 Paru chez Flammarion en 2009.
26 Dans son livre ‘The Question of Animal Awareness’ publié en 1976.
27 Introduction de ‘What is an animal ?’ paru en 1988 chez Unwin Wyman.
28 Précédemment cités.
Rousseau au pays de Saturnin
Surtout, les chercheurs en éthologie, en écologie comportementale et cognitive ont démontré que l’entraide comme bien des comportements sociaux avait des bases innées qui sont seules à pouvoir expliquer les sociétés supérieures d’insectes. La base innée de l’entraide appelée par Rousseau « bonté naturelle » de l’homme, credo qui paraissait si puéril et qu’il affirmait sans preuve, semble de plus en plus probable d’après ces sciences du vivant. Les sciences dites dures comme les neurosciences confirment cette base biologique de la morale. Nous serions donc « câblés » pour faire le bien : des cellules nerveuses spécialisées, les neurones-miroirs, sont excités quand nous imitons un proche ou quand nous faisons montre d’empathie et de compassion29. Cette réhabilitation du biologique dans l’humain ne signifie
29 Pour plus de précisions, lire par exemple le N° spécial de « Cerveau & Psycho – L’essentiel » de juillet 2014 intitulé ‘La morale : innée ou acquise ?
cependant pas que l’homme neuronal soit un robot ou un fauve, puisque notre espèce ne possède pas les fortes pulsions instinctives d’un loup et qu’elle peut contrôler (ou réprimer) par le culturel ses tendances innées.
Le devin du village (apport de la paléoanthropologie)
Lorsqu’il connaît l’illumination de Vincennes, en 1749, puis rédige le Discours sur les sciences et les arts, Rousseau prend le contrepied des Encyclopédistes en devenant le grand ennemi de la civilisation et du progrès. Il ne s’agit pas seulement d’un coup médiatique pour se faire remarquer à ses débuts dans la littérature car, dans le second Discours, il décrit, dans la même veine, le drame que constitue pour l’humanité la perte de l’ordre de la nature et, dans Du Contrat social, il en prescrit le remède. Jean-Jacques a l’esprit systèmatique : sa pensée est réfléchie et cohérente, et constitue une véritable théologie naturelle. Dans cette théodicée originale, la bonté naturelle, sur laquelle repose pour lui la morale, suppose des conditions de vie permettant l’épanouissement de la nature humaine, de la conscience posée comme
« principe inné de justice et de vertu »30. Or ces conditions ne lui paraissaient plus remplies dans nos sociétés, de là une remise en question de l’éducation dans Émile.
Son postulat de base, sur lequel repose l’ensemble de sa philosophie, est l’existence d’un
Dieu d’ordre. « Que de sophismes ne faut-il point entasser pour méconnaître l’harmonie des
êtres et l’admirable concours de chaque pièce pour la conservation des autres », s’étonne-t- il31. La véhémence de ses plaidoiries les font souvent assimiler à des prêches, d’où son pouvoir de conviction : Rousseau est un prédicateur déguisé en philosophe, en « sophiste » disait Diderot. Il est cocasse de trouver sous la plume d’un si habile dialecticien la critique de la raison : « L’état de réflexion est un état contre nature, et l’homme qui médite est un animal dépravé »32. Et dans le Discours sur l’origine de l’inégalité, il affirme que la nature est parfaite mais que l’homme a amené le désordre, concluant dans Émile : « Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l’homme »33. Pour expliquer l’existence du mal chez un être bon pourtant conçu par le Grand Architecte, il lui faut faire intervenir un déséquilibre créé par le passage de l’état de nature, où se trouvait l’homme primitif innocent, à l’état social, lorsque la civilisation a tout perverti pour donner la propriété, les inégalités, les lois, les gouvernements, les guerres. Pourquoi ce passage de l’état naturel (solitaire) à l’état social ? Le Discours sur l’origine de l’inégalité y répond encore. C’est la nature qui subitement est devenu inhospitalière : elle a poussé les hommes à s’unir pour lutter contre les dangers. Ainsi Rousseau se démarque à la fois des Encyclopédistes en invoquant un Dieu ennemi du progrès et de l’Église en rejetant le péché originel…
Que peut-on dire aujourd’hui de cette construction complexe qui excelle à combiner des
éléments – souvent naissants à cette époque – de biologie, de préhistoire, d’histoire, de psychologie, de morale, de politique et de théologie ? Elle date évidemment beaucoup après toutes les découvertes des préhistoriens, des archéologues, des paléontolog istes, des éthologistes, des généticiens et des paléoanthropologistes dont le métier est de reconstituer le puzzle du passé des hommes. Le dernier demi-siècle a été particulièrement fructueux pour la connaissance de notre espèce, en particulier depuis les apports de la biologie moléculaire qui a permis de dater les restes par l’ADN.
Il était impossible d’expliquer la genèse du monde vivant sans faire appel à une force surnaturelle avant Darwin (qui se destinait d’ailleurs à être pasteur et avait étudié la théologie
30 Émile, livre IV, ET-OC VIII, p. 715
31 Émile, livre IV, ET-OC VIII, p. 691.
32 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, ET-OC V, p. 104.
33 Émile, livre I, ET-OC VII, p. 309.
lorsqu’il admirait la Providence divine). Diderot et Rousseau ont tous deux consacré leur vie à la quête du Saint Graal qu’est la compréhension de la nature humaine. Mais, si Diderot choisit le matérialisme et son ami de jeunesse, le spiritualisme, ces choix ne sont pas motivés par des preuves ou des indices, mais par des convictions philosophiques. L’athée de cette époque est presque aussi croyant que le déiste. Diderot ne fait-il pas acte de foi quand il imagine dans Le rêve de d’Alembert que de la boue peut naître un insecte par génération quasi-spontanée ? Cette idée de l’émergence d’êtres vivants à partir de la matière inerte s’est révélée pourtant fondée, comme l’ont montré les expériences biochimiques du siècle dernier sur l’origine de la vie. Mais Diderot sous-estimait grandement la complexité des organismes pluricellulaires qui ont mis 1,7 milliard d’années pour se différencier des bactéries, les premiers êtres vivants apparus il y a 3,8 milliards d’années sur la Terre, qui, elle, date de 4,5 milliards d’années. L’intervention d’un Dieu bienveillant qui crée le monde en une semaine était ainsi plus à même de rendre compte de la bonté naturelle de l’homme, à laquelle tous deux croyaient, que le matérialisme qui, à cette époque, ne pouvait expliquer scientifiquement l’innéité de la morale. La Providence divine, qui a longtemps été la seule manière d’expliquer la Création, a donc aussi permis à Rousseau d’expliquer la Nature humaine ! En fait, chez lui, l’idée de Dieu et celle de la Nature se confondent : la bonté naturelle renvoie aussi bien à la bonté divine qu’à la nature de l’homme ; elle est une manifestation supérieure de l’âme et, à ce titre, émane d’un être supérieur. Ainsi, ironie de l’histoire, Rousseau le croyant, qui remplaçait l’inné par Dieu, est plus proche de la neurobiologie de la morale que Diderot, matérialiste limité par son époque, qui, lui, faisait acte de foi culturaliste en écrivant à tort : « Il n’y a aucune notion morale qui soit innée »34.
Il est certain, en outre, qu’il n’y a jamais eu sur Terre d’homme isolé et asocial, comme
nous l’avons souligné au début. Cet état naturel n’a jamais existé mais il était indispensable à la rhétorique de Rousseau pour inclure l’homme parmi les autres espèces, qu’il considère comme naturelles, mais qui, à la différence de l’homme, n’ont pas évolué aussi brutalement que notre espèce après l’avènement de l’état social qui a tout perturbé. Si Rousseau avait à soutenir sa thèse aujourd’hui, elle le laisserait tout aussi libre que par le passé du choix de ses convictions philosophiques mais celles-ci ne lui seraient plus aussi nécessaires ‒ du fait de la théorie darwinienne de l’évolution, pour établir le mécanisme naturel de la biodiversité et de l’origine animale de l’homme. Il lui serait facile de retrouver son état naturel dans al période paléolithique qui a duré près de 200.000 ans chez Homo sapiens et qui est considéré aujourd’hui comme une période d’abondance par bien des préhistoriens et ethnologues35. Cette période est, d’ailleurs, toujours vécue par les derniers peuples de chasseurs-cueilleurs nomades, mais leur vie est devenue intenable par suite de la confrontation avec le monde moderne. Les ethnologues, qui les ont étudiés, concluent à l’opposé ce de qu’on supposait, que leur mode de vie est beaucoup moins contraignant que le nôtre : « Qu’il s’agisse de chasseurs-nomades du désert du Kalahari ou d’agriculteurs sédentaires nomades amérindiens, les chiffres obtenus révèlent une répartition moyenne du temps quotidien de travail infér ieure à quatre heures par jour »36. Le mode de subsistance de ces chasseurs-cueilleurs consistait à prélever les végétaux et animaux dans une zone, puis à se déplacer et à monter un nouveau campement pour revenir sur cet emplacement quelques mois plus tard, après que la nature eut renouvelé ses ressources. Mais les villageois et citadins, qui leur ont succédé depuis environ
10.000 ans, ont exploité, à leur différence, la terre et les animaux avec beaucoup plus de sueur
et de résultats. D’où une démographie non plus en équilibre mais galopante, la population mondiale y étant passée de centaines de milliers d’hommes à plus de sept milliards. Et de
34 Diderot, œuvres complètes, édition établie par J. Assezat, 1878, t.1, p.470.
35 Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance, Traduit en 1976 chez Gallimard.
36 Pierre Clastres, La société contre l’État, 1978, Éditions de Minuit, p.165-166.
l’avis général, un changement radical de mode de vie s’est produit à cette époque, d’où l’appellation consacrée de « révolution néolithique ».
Ainsi Rousseau pourrait continuer à opposer cette période initiale ( nullement mythique
contrairement à ce qu’il croyait lui-même) à celle qui a suivi, qu’il appelait l’état social et que l’on peut assimiler au néolithique, plus la période historique jusqu’à nos jours. Les champs de flèches préhistoriques, témoignant de batailles, et les ossements témoignant de morts violentes abondent à partir du néolithique. D’après bien des préhistoriens et archéologues, cette période, qui commence voici 12 à 10.000 ans selon les régions, se caractérise par l’agriculture et l’élevage, l’accumulation des ressources alimentaires, l’accroissement démographique, la naissance de la propriété privée, la constitution d’une caste de guerriers, la sédentarité et l’urbanisation, l’apparition des conflits, des charniers et du cannibalisme, des inégalités sociales et matérielles, des lois, des classes sociales et des gouvernants37. Les exterminations d’espèces et les disparitions de milieux naturels deviennent fréquentes et s’amplifient aujourd’hui avec la sixième extinction de la biodiversité, sans commune mesure avec celles, d’origine non humaine, qui ont précédées. Bref, à peu près tout, et même plus que ce que Rousseau critiquait dans les méfaits de « la civilisation »…
On peut prendre un plus grand recul en allant encore bien plus en arrière dans le temps, en
considèrant non plus notre espèce seule, Homo sapiens, mais le genre Homo, c’est-à-dire la famille humaine qui date d’environ 2.500.000 ans. Nous étions alors des primates arboricoles, frugivores et insectivores, vivant en forêt, surtout végétariens donc, à la différence des chasseurs beaucoup plus carnivores qui ont succédé et qui sont nos ancêtres directs. Cette hypothèse rejoint celle imaginée par Rousseau, lequel opposait, de même que la science moderne, les régimes alimentaires qui ont précédé l’humanité sédentaire, à ceux qui l’ont accompagnée et faisait, lui aussi, appel à une modification du milieu naturel pour expliquer le changement de mode de vie qui s’est produit de l’état naturel à l’état civil. Or, le fait est que la théorie de plus en plus dominante explique l’hominisation par une sécheresse qui a multiplié les savanes en Afrique et réduit l’habitat forestier de nos ancêtres simiesques.
Les premiers humains, ayant quitté les arbres et colonisant les milieux ouverts, marchaient debout sur leurs jambes et vivaient en groupes familiaux nomades pour chasser collectivement et se protéger des carnivores. Au fil des millénaires, leurs proies sont devenues de plus en plus grosses et abondantes au fur et à mesure de la croissance de leur cerveau et de l’efficacité de leurs armes (appelées pudiquement « outils » par les préhistoriens). D’autant plus que 25.000 ans avant la sédentarisation de l’homme, le loup, domestiqué et sélectionné pour donner le chien, l’aidait à chasser et à se défendre38. Le scénario de l’hominisation, qui a pris forme récemment grâce aux données de la science, se rapproche donc bien des supposées élucubrations rousseauistes d’un autre temps qui n’a jamais existé ! En outre, il faut considérer, d’une part, que la première et longue période (« état de nature » selon Rousseau ou paléolithique selon les préhistoriens) est justement celle où les adaptations originales de l’homme (le seul primate chasseur coopératif) se sont mises en place et, d’autre part, que la deuxième période (« civilisation » selon Rousseau ou néolithique + période historique) couvre seulement 5% de l’existence d’Homo sapiens (ou 0,4% de celle de la famille humaine), donc pas grand-chose, bien que, par une illusion d’optique due à notre culture, les derniers 10.000 ans nous paraissent si importants.
37 Emmanuel Anati, La religion des origines, traduit en 1995 chez Hachette ; Brian Hayden, L’homme et l’inégalité- L’invention de la hiérarchie durant la préhistoire, traduit en 2008 chez CNRS-Editions ; Lawrence H.Keeley, Les guerres préhistoriques, traduit chez Perrin2009 ; Maryléne Patou-Mathis, Préhistoire de la violence et de la guerre, paru en 2013 chez Odile Jacob.
38Pierre Jouventin, La domestication du loup, N° 423, janvier 2013 de Pour la Science, pp.42-49 ; Le chien a-t-il fait l’homme ? N°262, septembre 2014, de Sciences Humaines, p.50-51 ; M.Germonpré et al., Fossil dogs and wolves, Journal of Archaelogical Science, 2009, 36 :.473-490.
« La révolution néolithique » bouleverse non seulement notre mode de vie mais inverse notre rapport à la nature. Pendant tout le paléolithique, la Terre est exploitée extensivement. Les chasseurs-cueilleurs, comme nos ancêtres de la période que Rousseau nommait « l’état naturel », attendent que le milieu renouvelle les végétaux et les animaux pour les prélever encore, d’où une faible natalité due aux ressources limitées et aux déplacements continuels pour trouver de nouvelles ressources. Or, ce système apparemment peu rentable d’exploitation des ressources de la nature, s’avère en revanche durable et en équilibre, comme l’est aussi celui de nombre d’espèces sauvages qui s’adaptent à ce qu’elles trouvent sans surexploiter le milieu. Remarquons également que cette adaptation qui a duré 2,5 millions d’années chez les humains, peut se perpétuer indéfiniment selon ce modèle, puisqu’il se renouvelle et se régule seul. Par contre, les derniers 10.000 ans c’est-à-dire le néolithique plus la période historique (« la civilisation » de Rousseau) se caractérisent par une exploitation intensive des ressources naturelles par l’agriculture et l’élevage. Cela permet par l’accroissement du travail, de multiplier les ressources d’une surface donnée et donc d’élever plus de jeunes, d’où une démographie planétaire qui n’a jamais été contrôlée et aujourd’hui moins que jamais… Bref, ce développement à « court terme » s’essouffle, comme l’avait compris Malthus il y a plus de deux siècles, puisque les bouches à nourrir augmentent sans cesse alors que nous arrivons aux limites de la planète et des ressources.
Rousseau ne pouvait bien sûr imaginer à son époque toutes les menaces qui, aujourd’hui,
s’amoncellent sur notre monde et qui dépassent ses prédictions les plus pessimistes : pollutions industrielles et par les pesticides, réduction de la faune sauvage et des abeilles, épuisement des terres et baisse des rendements, désertification en Chine et ailleurs, élevages concentrationnaires, agriculture industrielle mécanisée appauvrissant les sols, raréfaction des sources d’énergies, des matières premières et des terres rares, spéculation financière illimitée, guerres politiques et écologiques portant en particulier sur les ressources en eau, mondialisation (qui, dans un premier temps, a augmenté les ressources des pays pauvres mais qui concurrence et appauvrit maintenant les pays riches), surpopulation, famine s, guerres ethniques et religieuses, migrations humaines, changement et réchauffement climatiques, réduction de la biodiversité, augmentation du niveau de la mer, recul du trait de côte, etc… On peut donc avancer que ce « devin du village planétaire » qu’était Rousseau, a eu l’intuition prophétique d’une première très longue période où notre espèce était « épanouie » car adaptée à sa niche écologique, puis d’une deuxième période courte et récente où notre espèce a dû adopter un mode de vie plus contraignant et complétement nouveau avec l’apparition de l’agriculture et de l’élevage. Les villes et les États sont apparus, puis l’industrialisation et la technologie qui ont multiplié notre impact sur la planète. Elles nous ont entrainés dans cette course sans fin que dénonçait Rousseau et dont nous ne savons plus comment sortir, 250 ans après ses mises en garde. Bref, il me semble difficile de ne pas considérer Rousseau comme un extraordinaire précurseur. Son approche critique et passéiste a longtemps paru pessimiste et pathologique, mais elle se révèle de plus en plus exacte et prophétique.
Comment expliquer ce don de devin qui tranche tant sur son époque où les progrès matériels et technologiques incitaient à l’optimisme ? Sans doute le pessimisme et la lucidit é de ce misanthrope, qui explorait si bien la nature humaine, est-il dû en partie à son éducation puritaine et calviniste, à laquelle il reviendra en fin de vie et qui l’a empêché de céder aux séductions du progrès matériel comme Voltaire et Diderot. Plus encore, « le pauvre Jean- Jacques » n’a pas connu sa mère, a été rejeté par son père, a vécu comme vagabond et valet, puis comme obligé des riches qui l’hébergeaient. Ses amours, sa sensibilité exacerbée, ce besoin perpétuel de se justifier, d’analyser ses malheurs et ceux de l’homme, cette rage de convaincre, cette haine des possédants et des privilégiés qui n’ont pas ses dons, des intellectuels qui le persécutent et des intimes qui ne peuvent le comprendre et en sont arrivés à le haïr, sont liés à ce manque affectif et à cette déchéance sociale (Madame de Warens, sa
bienfaitrice et sa maîtresse, qu’il appelait « Maman » et qui l’a abandonné ; sa compagne
d’humble condition qui lui a donné des enfants qu’ils n’ont pu élever, etc…).
Il n’est donc pas étonnant que nous assistions à une renaissance de ce courant
catastrophiste auquel Rousseau appartenait isolément à son époque. De plus en plus de penseurs y reviennent et s’inquiètent, sans pour autant avoir la vision pessimiste qui le caractérisait et lui a ouvert les yeux sur les dangers du progrès. Jared Diamond a eu paradoxalement un succès mondial avec son livre Effondrement. Chez nous, Yves Paccalet, pour éveiller les consciences, a carrément intitulé son succès de librairie : L’humanité disparaîtra, bon débarras ! Il existe également actuellement aux États-Unis celui qui me paraît être un disciple moderne de Rousseau, John Zerzan, qui se qualifie de philosophe de l’anarcho-primitivisme et qui s’appuie sur les travaux d’ethnologie et d’anthropologie pour critiquer la civilisation, oppressante dans son essence. Il prône un mode de vie plus libre, inspiré des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, et un retour aux petites communautés. Proche de Theodore Kaczynski39 (plus connu sous le nom de Unabomber) mais pacifiste, il va jusqu’à critiquer la domestication des animaux, le langage, la pensée symbolique (des mathématiques jusqu’à l’art) et le concept de temps dans nos sociétés. Il est en particulier l’auteur d’un pamphlet intitulé Futur primitif dont la présentation rappelle son prédécesseur, non dans le vocabulaire mais dans le ton : « Nous avons pris un mauvais tournant monstrueux avec la culture symbolique et la division du travail ; nous avons quitté un lieu d’enchantement, de compréhension et de totalité pour atteindre l’absence que nous trouvons aujourd’hui au cœur de la doctrine du progrès. Vide, et de plus en plus vide, la logique de la domestication, avec ses exigences de totale domination, nous montre aujourd’hui la ruine d’une civilisation qui ruine tout le reste. Présumer de l’infériorité de la nature favorise la domination des systèmes culturels qui ne vont pas tarder à rendre la Terre elle-même inhabitable… »40. Enfin, comment ne pas rapprocher Rousseau d’un autre génie dont la vie a été encore plus mouvementée, qui fut mon ami et vient de finir sa vie en ermite paranoïaque ? Je veux parler du plus grand mathématicien de notre époque et peut-être de tous les temps, Alexandre Grothendieck, anarcho-écologiste opposé à la technoscience et surnommé « Le prophète », dont les prédictions sur l’avenir de notre monde étaient encore plus sombres. Devenu mystique, il répétait sur le marché de Saint-Girons aux rares personnes qu’il fréquentait :
« Mais pourquoi le mal existe-t-il ? »41.
Il est vrai que le passé de l’homme, qui nous a toujours été dépeint dans les livres d’histoire comme glorieux, peut être réinterprété en négatif. Si l’on en croit , en effet, les travaux récents de la paléoanthropologie, notre niche écologique a consisté à chasser en clans de gros animaux, ce qui n’est plus évident aujourd’hui en particulier pour les sciences humaines. Or, quelques milliers d’années après que les hommes eussent colonisé chaque nouveau continent, la paléontologie démo ntre que sa mégafaune disparaît. C’est ce qui s’est passé d’abord en Afrique il y a environ deux millions d’années42, puis en Eurasie (grands mammifères représentés à Chauvet puis disparus après l’arrivée d’Homo sapiens), en Amérique du nord (grands herbivores et carnivores disparus après la colonisation huma ine à partir de l’Asie), en Australie (marsupiaux géants herbivores et carnivores disparus après la colonisation par les aborigènes), à Madagascar (lémuriens géants et oiseaux-éléphants exterminés après l’arrivée de l’homme), en Nouvelle Zélande (famille des moas, grands
39 Theodore Kaczynski. La société industrielle et son avenir. Éditions de l’encyclopédie des Nuisances, 1998.
40 John Zerzan, Futur primitif, publié en 1994 et traduit en 1998 chez L’insomniaque. Un autre livre du même
auteur est paru chez le même éditeur en 1999 qui critique la technologie et l’industrie : Aux sources de l’aliénation. Il a aussi édité en 2005 une anthologie en anglais intitulée Against civilization dans laquelle se trouve le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité de Rousseau.
41 http://www.scilogs.fr/ecologie-science-societe/search/Grothendieck : courte biographie d’Alexandre
Grothendieck par Pierre Jouventin sur le site de la revue Pour La Science.
42Lars Werdelin, Le vrai roi des animaux, Pour la Science, février 2014, n°436, février 2014.
oiseaux aptères exterminés après l’arrivée des maoris). On ne sait pas encore comment ont disparu les quatre ou cinq hommes qui, comme je l’ai précédemment évoqué, cohabitaient avec nous, il y a 40.000 ans. Mais cela peut noircir encore le tableau, sachant par exemple que les néandertaliens ont eux aussi disparu quelques milliers d’années après l’arrivée des hommes modernes en Europe43 et que l’homme de Flores (qui faisait un mètre de haut et possédait un cerveau de la taille d’une pamplemousse) a disparu vers 60.000 ans avant Jésus- Christ avec toute la mégafaune de cette île à l’arrivée de l’homme…44 Les derniers chasseurs- cueilleurs de notre planète sont d’ailleurs au seuil de l’extinction, tout autant que les différentes espèces de grands singes, nos cousins. Voilà bien des coïncidences pour un seul homme : notre espèce a-t-elle fait disparaître les espèces proches, qui la concurrençaient ou lui apportaient beaucoup de viande ? Car si notre cerveau pèse 2% du corps, il consomme
25% de notre énergie, d’où un énorme besoin de protéinesà satisfaire. Nous avions noté au passage le paradoxe de Rousseau, dialecticien surdoué, qui attribuait à notre intelligence notre déchéance, mais l’ascension accélérée et unique dans le règne animal de celui qui est devenu le Roi de la Création, ce démiurge qui a modifié l’équilibre planétaire et qui se demande comment durer, est-il dû comme le prétendait Jean-Jacques à un excès d’innovations culturelles et de raison ? Pour prendre un peu de hauteur et de modestie, rappelons que l’existence de l’homme moderne date de 200.000 ans, celle des néandertaliens a duré plus de
300.000 ans donc 50% de plus, celle de notre ancêtre primitif Homo erectus plus de deux
millions d’années. Quant aux dinosaures, ils ont régné en maîtres pendant 160 millions
d’années…45
Le Judas de la troupe sacrée (Conclusion).
Parmi les Encyclopédistes qui tentaient de comprendre l’effondrement de l’ancien régime, de prédire l’avenir technologique et d’orienter la société, Rousseau est isolé et en contradiction avec ses optimistes frères ennemis, fervents de la Raison et apôtres du Progrès. Son modèle littéraire, puis son plus perfide ennemi, Voltaire, le qualifiait d’ailleurs de « Judas de la troupe sacrée ». Même son ami et conseiller littéraire, Diderot, a rompu en considérant le
« grand sophiste » comme une entrave au devenir de nos sociétés puisqu’il ne mettait pas, d’après lui, sa plume au service de l’humanité. En réalité, nous pensons avoir montré que Rousseau était plus en avance sur son temps que même ses admirateurs le pensaient (du moins sur sa conception de l’homme car sa politique nous paraît moins convaincante, échouant à concilier liberté individuelle et cohésion sociale). Sa critique du progrès et de la civilisation, son primat de l’humain sur l’économique, qui ont causé son rejet puis sa persécution, semblent se vérifier chaque année davantage avec la crise écologique, financière, sociale et politique qui a débuté.
Il s’est rarement trompé, quoiique confondant société et civilisation pour tenter de combler les lacunes de son époque sur le passé de l’homme. Cette erreur, sur l’homme primitif qui aurait été solitaire et qui hérissait Konrad Lorenz à juste titre, peut être considérée comme un malentendu. En effet, pour Rousseau, l’état initial est théorique, « naturel » étant pour lui synonyme d’« essentiel ». « Cet état n’a peut-être jamais existé » et « probablement n’existera jamais » reconnaissait-il de l’état de nature : il était en fait trop prudent dans sa préface au second Discours en affirmant que la préhistoire resterait un mystère. À propos de cet ancêtre imaginaire, il ne le considérait d’ailleurs pas comme asocial puisqu’il écrivait dans le livre IV d’Émile, qu’il avait « des vertus sociales en puissance ». Les connaissances nouvelles
43 Maryléne Patou-Mathis, Néanderthal, une autre humanité, 2008, Perrin.
44Pour La Science de mai 2016, p.13.
45 En octobre 2016, paraitra un nouveau livre de Pierre Jouventin sur ce sujet iconoclaste –L’homme, cet animal
raté- chez Libre & Solidaire.
confirment donc étonnamment ses intuitions, et ce jusqu’à cette supposée erreur, cet état de nature qu’il croyait fictif mais qui peut être assimilé au paléolithique. Bref, pour reprendre la formule de Gustave Lanson, Rousseau se trouve bien « à l’entrée de toutes les aventures du temps présent ».
Au-delà des malveillances de Voltaire qui poursuivit de pamphlets anonymes Rousseau en
Angleterre et en Suisse, dévoilant l’abandon des cinq enfants de l’auteur d’Émile et provoquant la lapidation de sa maison, l’autodafé de sa bibliothèque et la fuite de Jean- Jacques dans l’île de Saint-Pierre, il faut reconnaître que le pessimisme du vieux sage (Candide), son relativisme (Cultivons notre jardin ) et son bon sens (« Si tout n’est pas bien, tout est passable ») vont plus loin que son adversaire sur la question de la Providence, touchant le problème insoluble de la coexistence du Mal avec la bonté d’un Créateur. D’ailleurs, Rousseau lui répond faiblement par le besoin de croire en Dieu pour espérer en une vie meilleure, et, très doué pour se faire plaindre, il attire la sympathie comme victime : il est vrai que Voltaire était trop bien adapté à son époque, d’où sa réussite sociale, sentimentale et financière, à l’opposé des échecs du « pauvre Jean-Jacques ». Le civilisé vantait les mérites de la culture et le barbare, ceux de la nature : comment les deux hérauts de l’antagonisme nature/culture sur lequel repose la philosophie occidentale auraient-ils pu s’entendre ? Voltaire et Rousseau, les deux monstres sacrés des Lumières, qui reposent aujourd’hui côte à côte au Panthéon, n’ont jamais rien eu à se dire : le vieux serpent l’a toujours su, alors que le jeune naïf a longtemps confondu la forme (magistrale) et le fond (réactionnaire). Même dialogue de sourds avec l’autre frère ennemi, Diderot, l’apôtre du Progrès, qui fut pourtant l’intime de Jean-Jacques, l’apôtre du « Regrés », selon le mot d’Élisée Reclus, partageant sa croyance en un âge d’or. Brillant, ouvert, idéaliste, admirateur des primitifs et passionné comme lui par la nature humaine, l’animateur de l’Encyclopédie était trop confiant dans les sciences et les arts, dans le démon de la connaissance. Son talent demeure, mais sa vision, longtemps en avance sur son temps, a perdu de sa pertinence.
Les Lumières s’éteignent : Rousseau, plus seul que jamais parmi les grands esprits de son
temps, est devenu l’annonciateur du monde désenchanté et crépusculaire dans lequel nous entrons. Sa réputation de persécuté et de paranoïaque n’était pas usurpée, surtout à la fin de sa vie où il était accablé – comme le mathématicien Alexandre Grothendieck – par l’incompréhension et l’adversité, tant il « dérangeait » comme écrivait Flaubert à la poétesse Louise Colet. Ce calviniste a été bien plus haï par le clergé que les athées, critiquant la foi par l’intérieur et reprochant aux religions leur formalisme. Les possédants ont aussi été scandalisés par ses appels séditieux au peuple, Voltaire, le premier, le défenseur des libertés qui spéculait sur les lupanars et l’esclavage46. Auguste Comte dans son Cours de philosophie positive souligne sa « désastreuse influence sociale » et l’archevêque de Paris estimait en
1934 qu’il a fait « plus de mal à la France que les blasphèmes de Voltaire et de tous les
Encyclopédistes ».
Néanmoins, à l’aube d’une époque où les sciences et techniques prouvaient leur capacité à
changer le monde, ce prophète de l’apocalypse a perçu, en observant l’horizon par-dessus la tête des esprits les plus cultivés et lucides de son temps, contre leur avis et malgré les persécutions, que les orages et les catastrophes ne manqueraient pas d’arriver après cette époque euphorique qui commençait. Notre écorché vif a prédit intuitivement cette venue des temps difficiles un quart de millénaire à l’avance ! Il en a analysé les causes, parfois d’une manière dépassée par l’évolution des sciences, mais le plus souvent avec pertinence, chose surprenante quand on tient compte des connaissances de l’époque. Comment expliquer cette préscience, au sens littéral ? Elle est due peut-être à son enfance difficile et à sa vie aventureuse, qui l’ont rendu pessimiste, d’où sa maladresse sociale, sa sensibilité extrême et
46 Jean Aurieux, Voltaire ou la royauté de l’esprit, 1966, Flammarion.
sa critique radicale d’autodidacte révolté. Son calvinisme l’a fait se méfier du luxe et de l’hypocrisie donc du Progrès, qu’il a fustigé grâce à son intelligence brillante, sa cohérence philosophique, sa rhétorique passionnée et sa conviction profonde.
Il me paraît cependant exister une faille dans son argumentation : comment un Dieu tout- puissant a-t-il pu laisser « le bon sauvage » sortir de l’état de nature pour créer la Civilisation qui ferait son malheur ? Rousseau arguerait sans doute comme un bon théologien qu’il a laissé à l’homme le libre-arbitre, la liberté de se tromper, mais il faudrait supposer soit un Bon Dieu aveugle, soit omniscient et pervers… Longtemps, nos mythologies ont constitué des ébauches naïves des sciences de l’évolution, qui ont seulement pu, au dix-neuvième siècle, se passer du surnaturel. De même, le déisme de Rousseau lui a permis d’imaginer un scénario du passé de l’homme cohérent avec les données actuelles de la paléoanthropologie et de la préhistoire. Sa thèse de la nature humaine reposant sur l’intervention divine, parfois naïve, s’est donc révélée plus pertinente que celle conçue par la science de l’époque, d’où l’échec de Diderot. Le théisme de Rousseau reste d’ailleurs plus explicatif que les philosophies actuelles qui nient la génétique du comportement et veulent que tout soit culturel, acquis, appris. Il constitue donc, comme la Bible pour le darwinisme, un modèle préliminaire mais heuristique, aujourd’hui relayé par les sciences qui proposent enfin des explications naturelles du comportement animal et humain.
Voltaire, en décochant cette méchanceté à Rousseau : « On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre bêtes », se moquait du raté moralisateur, qui n’avait pas su utiliser ses dons pour s’enrichir comme lui et être heureux dans le présent . Espérons que nous ne soyons pas, dans l’avenir, obligés « de marcher à quatre pattes » pour ne pas l’avoir entendu.
Pierre JOUVENTIN
Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....
.
EDUCATION CANINE & CHIENS-MEDECINS

‘Le chien, un loup rempli d’humanité’ La Fontaine
Les études, que nous avons brièvement présentées, concluent toutes que le meilleur ami de l’homme constitue le champion toutes catégories pour décoder nos comportements et nos émotions. Le chien comprend mieux les humains que nous, ce qui parait surprenant mais qui est explicable, comme nous avons essayé de le montrer ici. 51% des foyers français abritent un chien d’après une récente enquête TNS/SOFRES. Avec 8 millions, notre pays occupe la première place européenne et le deuxième rang mondial pour le nombre de chiens par habitant après les Etats-Unis où ils sont 70 millions. C’est dire l’importance sociale et -totalement méconnue- de ce que l’on a appelé les ‘chiens-médecins’…
Les règles de vie sociale des canidés et en particulier du loup sont autrement plus strictes que les nôtres mais elles en sont cependant très proches. Cette extraordinaire complicité entre canidés et humains explique la valeur thérapeutique reconnue du chien pour les gens âgés et les enfants fragiles. Une étude israélienne récente a montré que les enfants possédant un chien à la maison étaient moins stressés et présentaient une pression artérielle moins élevée que ceux qui n’en avaient pas. Ces animaux-médecins représentent pour les dépressifs et/ou les isolés des amis bien plus affectueux et indulgents que leurs congénères qui les jugent. Parfois même, le compagnon canin constitue une raison de vivre par les soins qu’il nécessite et la responsabilité qu’il engage, des gens âgés et solitaires reprenant goût à la vie à leur contact.
Plus directement encore, des laboratoires cherchent à utiliser les capacités olfactives des chiens pour les transformer en auxiliaires de la médecine afin de prévenir les crises de diabète ou d’épilepsie de leur maître. On sait que les chiens sont infiniment plus performants que nous sur le plan olfactif. Ils détectent par l’odeur les molécules volatiles particulières qui accompagnent les cancers de la peau, du sein, des poumons. Dans des expériences contrôlées où ils sont récompensés de leurs bonnes réponses, ils distinguent très facilement -parfois à 100%- les échantillons d’urine provenant de malades du cancer de la vessie de ceux d’individus sains. Les scientifiques chinois ont aussi essayé de mettre à contribution leur capacité à percevoir l’arrivée des tsunamis, tremblements de terre et ouragans mais un animal est moins facile à utiliser qu’un détecteur de séismes.
Les enfants ne sont pas indifférents aux chiens qui élargissent leur univers social et, souvent, ils sont fascinés: c’est la période d’apprentissage de l’Altérité et de construction de l’Identité, à laquelle contribue la découverte d’un compagnon si différent des humains car il comprend tout et console mais ne parle pas… Dans une tribu ou une ferme à l’ancienne, l’enfant pouvait comparer des individus du même sexe, des deux sexes, de plusieurs générations et même comparer des humains avec des animaux. Un chien dans une maison constitue généralement un membre à part entière de la famille. Mais les enfants ne parviennent pas toujours à l’assumer et les parents ne doivent prendre un compagnon-animal que s’ils sont prêts à s’en charger eux-mêmes en cas de défaillance. Bien des enfants, qui avaient peur des animaux, oublient leur angoisse quand ils fréquentent un grand chien ou même, comme mon fils Eric, une louve.
Disons un mot d’éducation canine, bien que ce ne soit pas le centre de ce livre et que les problèmes difficiles nécessitent une consultation de comportementaliste. Aux USA où les chiens sont si nombreux, cela s’accompagne de 5 millions de morsures et d’abandons/an, car beaucoup trop de maîtres ne savent pas ‘lire’ leur chien, c’est-à-dire décoder leurs signaux qui sont pourtant typiques. Ils sont parfois tellement séduits par leur mascotte qu’ils lui prêtent des sentiments humains et lui parlent comme à un ami, le raisonnant alors qu’il ne peut tout comprendre. Il faut donc connaître la psychologie du chien qui dérive de celle du loup, respecter sa personnalité non humaine et ses capacités de compréhension, ne pas en faire un sous-homme mais un individu différent qui a ses propres règles de savoir-vivre.
Quelques consignes doivent être suivies. Il est exceptionnel qu’un loup ou un chien attaque sans prévenir et il est donc généralement possible d’éviter la morsure si on sait interpréter attitudes et grognements. Il ne faut jamais acculer un animal sauvage ou domestique dans un réduit sans issue, ni punir un chien apeuré car il peut se retourner et mordre. Tout parent doit éviter de laisser un bébé seul avec un chien, initier dés que possible l’enfant au respect de l’animal et l’animal au respect de l’enfant en le grondant dés qu’il devient menaçant et sans attendre, apprendre à l’enfant la signification des comportements canins en particulier des messages de menace, lui interdire d’approcher d’un chien qui mange ou d’un chien étranger en le fixant dans les yeux (ce qui est pour eux une provocation), ne pas s’enfuir en courant et en gesticulant mais en reculant ou en l’évitant lentement.
Bien des propriétaires font des erreurs dont ils accusent le chien dont ils veulent ensuite se débarrasser. L’attitude du maître doit être dépourvue d’ambiguïté ce qui n’est pas toujours évident car, croyant faire son bonheur, le maître agit souvent en plaçant son chien dans le rôle du leader. Les conflits entre humains et chiens résultent presque toujours de ce malentendu hiérarchique : distribuer la nourriture, décider du moment et du but de la promenade font partie du travail du chef de meute que l’homme doit nécessairement assumer ; manger en premier, refuser le passage en font aussi partie, mais souvent le maître n’en a pas conscience lorsqu’il mange après son chien, lorsqu’il le laisse décider des sorties, lorsqu’il l’évite et l’enjambe pour ne pas le déranger alors qu’il devrait le faire se lever et s’écarter quand il bloque une issue. Bref il fait involontairement croire au chien qu’il lui cède la dominance d’où l’incompréhension et le conflit ensuite.
.
LES ANIMAUX POSSEDENT-ILS UN LANGAGE ?
‘Le point d’achoppement central reste toujours celui du langage’ Dominique Lestel (‘L’animalité)
Cette question est en soi une réponse puisque dans langage, il y a langue, c’est-à-dire au sens non anatomique la particularité majeure de l’espèce humaine. Il est bien évident que celui qui formule la question en ces termes souhaite que l’on conclue en affirmant une fois encore que notre espèce est le seul être vivant à posséder un ‘véritable’ langage, ce qui démontre sa supériorité sur le règne animal.
Ce type de raisonnement est aussi subjectif que celui qui consisterait, dans une société de baleines, à organiser un débat autour du thème « Les autres espèces possèdent-elles une taille comparable à la nôtre ? ». Et même, cette formulation serait plus honnête car parler ‘d’autres espèces’ est autrement plus exact que parler d’‘animaux’, en sous-entendant que l’Homme n’a rien de commun avec ses ‘frères inférieurs’ selon l’expression de Michelet.
Le fait, d’une part d’avoir mis dans la même catégorie animale des espèces aussi différentes qu’un ver de terre, une huître, une éponge (c’est un animal) et un chimpanzé, d’autre part d’avoir classé dans des catégories distinctes des êtres vivants aussi proches que le chimpanzé et l’homme n’est pas neutre et pose aujourd’hui problème, pas seulement moralement mais scientifiquement. Le chimpanzé est séparé de l’homme par 1,23% de divergence génétique et tous deux sont séparés du gorille par 2,3%. Les analyses d’ADN -même si elles doivent être complétées par d’autres critères- montrent aussi que le plus proche parent du chimpanzé n’est pas le gorille mais l’homme et un autre chimpanzé reconnu récemment, le Bonobo.
Je me souviens de l’abîme de perplexité dans lequel j’avais plongé des étudiants de l’Université de Vincennes en leur posant cette anodine question : ‘L’homme est-il un animal ?’. Un blasphème provoquerait aujourd’hui moins d’effet dans une église. Pourtant, d’après la définition du Petit Larousse, un animal est un ‘être organisé, doué de mouvement et de sensibilité, et capable d’ingérer des proies solides à l’aide d’une bouche’. Il devrait donc être incorrect de réserver le mot ‘animal’ aux espèces autres que l’homme. En fait, cette licence est admise du fait de notre héritage culturel car les grecs ne connaissaient pas les grands singes et ils ont défini l’humain par opposition à l’animal (‘Barbare’ signifiait en grec ‘étranger’ et ceux qui ne parlaient pas leur langue étaient considérés comme quasi-animaux). Cette opposition et ce mépris des autres fondent toujours notre civilisation occidentale mais pas les autres cultures. Jusqu’au début du XVe siècle, les anthropoïdes étaient inconnus en Eurasie et l’homme, sur le plan de la raison et de l’affectivité, était séparé des non-humains par un fossé autrement plus grand que de nos jours. Cette définition de l’homme, qui est remise en question par bien des auteurs comme Philippe Descola auteur de ‘Par delà nature et culture’, est donc discutable et traduit bien la répugnance qu’ont la plupart des humains – aussi libérés des préjugés qu’ils croient être – à se mettre sur le même plan que les autres êtres vivants.
De même que l’on excluait, il y a peu, les noirs de l’espèce humaine – ce qui ne posait pas de problème même à Voltaire qui spéculait sur la vente des esclaves –, on refuse d’accepter l’évidence que l’homme est un animal. Pourtant, l’espèce Homo sapiens ne nous parait si importante que parce que nous en faisons partie. Linné, dans la première classification connue des êtres vivants, classait le chimpanzé dans le même genre Homo que nous et la biologie moléculaire a montré que son analyse était la bonne, l’homme étant génétiquement beaucoup plus proche des chimpanzés qu’on le supposait. C’est dans les 1,23% de différence que se trouve toute notre spécificité humaine, ce qui ne lui enlève rien mais la relativise. L’homme moderne ironise sur l’époque où l’on croyait que toutes les planètes tournaient autour de la terre mais il continue à se croire le centre du monde, le roi du monde animal , l’aboutissement et le sommet de l’évolution.
Il est vrai que les baleines -qui ne parlent pas mais chantent- ne sont pas prêtes à organiser un congrès pour dire le contraire. Ne serait-ce que parce qu’elles ont été pratiquement exterminées. L’Histoire a toujours été écrite par les vainqueurs… Il ne suffit pas à notre espèce d’avoir décimé la plupart des autres espèces, il lui faut encore se donner bonne conscience et justifier le massacre. Pour se mettre hors concours, il lui faut introduire une différence de nature entre soi et les autres. Il n’y a pourtant pas si longtemps, les Autres se trouvaient dans une vallée voisine, derrière une montagne, de l’autre côté d’un fleuve, ils parlaient une autre langue, pratiquaient une autre religion ou avaient une autre couleur de peau. Il est vrai que de savants ethnologues expliquaient ou expliquent encore, en croyant énoncer des vérités scientifiques, que ces sociétés qualifiées de ‘primitives’ ne possèdent pas l’écriture ou la roue ou la notion de Dieu, ce qui démontre notre supériorité et autorise toutes les exploitations, tous les mépris.
Aujourd’hui, le racisme -ici le ‘spécisme’- n’est plus de mise et les Autres, ce sont les Bêtes, qui, comme leur nom l’indique, ne peuvent pas posséder l’intelligence, ni le langage, ni la faculté d’abstraction, ni l’outil, ni le pouce opposable aux autres doigts, ni la station debout, ni la bipédie bref aucune des caractéristiques de l’Homme… Or la science moderne a confirmé que tous ces critères -qui ont été choisis car ils semblaient constituer nos supériorités et donc le Propre de l’Homme- existent tous chez les animaux même s’ils sont moins développés. On en revient toujours à la différence de degré et non de nature entre l’homme et les autres espèces, comme l’affirmait Darwin il y a un siècle et demi. Rien n’empêche pourtant de juger, si on veut absolument être uniques dans le monde vivant, que cette minuscule différence génétique entre l’homme et son plus proche parent, le chimpanzé, est fondamentale pour notre identité puisque c’est en elle que se trouvent inclus le langage et tous les caractères où nous excellons…

.
LE LOUP, CREATURE DU DIABLE
1. LE LOUP, CREATURE DU DIABLE
« Le loup représente le diable, car celui-ci éprouve constamment de la haine pour l’espèce humaine et il rôde autour des pensées des fidèles afin de tromper leurs âmes » Anonyme du XIIIe siècle.
« Le loup est un animal terrible. Sa morsure est venimeuse parce qu’il se nourrit volontiers de crapauds. L’herbe ne repousse plus là où il a passé. » Barthélemy l’Anglais, XIIIe siècle.
Il y a deux loups, le vrai, celui qui vit dans la nature, et l’autre qui vit dans notre imaginaire. Thomas Hobbes (dans ‘Le Léviathan’1651) justifiait le despotisme par le fait que l’homme est naturellement mauvais. Sa formule lapidaire (reprise du dramaturge latin Plaute) ‘L’homme est un loup pour l’homme’ fait du loup l’archétype de l’être anti-social alors que c’est exactement l’inverse. Cet animal sauvage a toujours rempli dans la civilisation occidentale un rôle de repoussoir et l’imaginaire sur le loup est en conséquence le plus riche qui soit. D’après Bruno Bettelheim, ‘Nous attribuons au loup ce qu’il y a de plus terrifiant en nous-même’. Cela mériterait un autre livre mais nous nous bornerons à un encart émaillé de citations du livre de Robert Delort ‘Les animaux ont une histoire’ (référence en fin de volume).
La fascination pour le loup, comme sa rivalité avec notre espèce qui en est le contrepoint, ne datent pas d’hier. ‘L’ensemble des daces mais aussi nombre de gaulois se sont estimés fils du loup, et plus de mille deux cent familles françaises choisiront l’emblème du loup pour leurs armoiries’ (p .325). Dés le Xe siècle, Edgar-le-pacifique l’avait éradiqué des îles anglaises en exigeant des populations un tribut payé en têtes de loups. Le capitulaire de Charlemagne en 813 désignait pour chaque comté deux spécialistes de la destruction des loups. Or, après une éclipse due aux abus de pouvoir, la charge de lieutenant de louveterie s’est maintenue deux siècles après la disparition des loups dans les vingt-deux régions administratives françaises. Bien que le titre ait été conservé, il s’agit plutôt aujourd’hui de conseillers cynégétiques.
A partir du XVéme siècle, le loup, pour les croyants, était, comme le diable, innommable : on disait plutôt ‘la beste’ ou tout simplement ‘il’. L’Occident chrétien associait loup-péché-diable-mort-enfer et, dans l’imagination populaire, le loup constituait l’incarnation du mal. Le loup représentait l’archétype de l’Autre, le païen, l’incroyant, le rebelle, le juif, le huguenot, celui qui refuse l’ordre établi et qui bafoue les règles de la cité. Il était souvent associé à la femme, Eve, accusée d’avoir créé le mal en croquant la pomme qui nous a fait exclure du paradis terrestre… Il était le négatif du chien créé par Dieu (alors que, pour les musulmans, ‘le meilleur ami de l’homme’ est impur pour sa sexualité débridée et sa tendance à se nourrir de déchets)… Suppôt du diable, du ‘malin’ ce qui explique sa ruse, reflet de nos péchés, le loup était celui qui mange l’agneau mystique, symbole du christ (‘A l’évidence, c’est la bête que Dieu envoie pour châtier les hommes et égorger les brebis égarées privées de leur bon pasteur’ p.325). ‘La liaison devient évidente avec la magie, la sorcellerie, la nécrophagie, la cannibalisme, l’infanticide et la sexualité. Que de loups chevauchés à l’envers pour rejoindre le sabbat ! Que d’incantations, de maléfices, de mixtures effrayantes incorporant des fragments de loup ; que d’orgies en leur compagnie sous la lune blafarde, dans la nuit sombre, la caverne ou le fond des bois ! Et que de suspicion, de terreurs ou de haine envers les hommes qui fraient avec les loups ! » (p.344). Le ‘meneur de loup’, qui passait dans les villages pour exhiber ‘La bête’, rejoint l’homme-loup au centre ‘des contes fantastiques, sadiques, érotiques ou masochistes’ et le loup-garou anthropophage manifestant ‘une sexualité brutale et une force meurtrière’.
Dans la mythologie antique, germanique, scandinave, il est très présent comme pourvoyeur des enfers ou gardien du royaume des morts. En Grèce, le chien à trois têtes, Cerbère, veille sur l’Achéron, le fleuve qui conduit aux enfers (mais aussi, Argos, le chien d’Ulysse est le premier à le reconnaître à son retour et en meurt d’émotion). Chez les Aztèques, le chien Xolotl escorte les âmes. En Chine, Tien Kuan chaperonne les esprits voués à la vie éternelle. Dans l’Egypte pharaonique, Anubis, le dieu des morts à tête de chien, patron des nécropoles, préside à la momification des corps, puis conduit les âmes pour être jugées et il détruit les ennemis de la lumière. A Cynopolis, les habitants de la maison dans laquelle un chien a vécu se rasent la tête et jettent la nourriture en signe de deuil. A Abydos et Thèbes, ont été découverts des cimetières remplis de milliers de momies de chien…
Les légendes mettant en scène le loup sont innombrables dans toutes les civilisations indo-européennes et nord-américaines car cette ‘bête envoyée par le Diable’ a toujours été utilisée pour effrayer ceux qui étaient tentés de transgresser les interdits sociaux, en particulier les femmes. Pour se limiter au conte le plus connu chez nous, le Petit Chaperon Rouge, il a été décodé (en particulier par Bruno Bettelheim dans ‘La psychanalyse des contes de fées’) : ce n’est pas du tout un récit au premier degré pour enfant comme on le croit au premier abord, mais une allégorie mettant en garde à mots couverts les jeunes filles du danger des rencontres masculines, le loup dont il s’agit n’étant pas un animal mais un homme sexué, au sens où l’on dit toujours d’une fille qu’‘elle a vu le loup’… D’ailleurs dans la Rome antique, le loup était l’emblème d’une sexualité débridée, une louve désignant une prostituée et ‘lupa’ ayant donné le mot lupanar, synonyme de maison close : en conséquence, certains historiens pensent que la louve, qui aurait élevé les deux fondateurs de Rome, était en réalité une femme de mauvaise vie embellie par la mythologie…
Frappés par sa capacité au combat et sa discipline de groupe, entretenant cette peur du loup pour perpétrer des crimes en terrorisant les populations, des sociétés secrètes guerrières se sont revendiquées fils ou frères des loups chez les Grecs, Romains, Perses, Indiens et ce, depuis l’Antiquité jusqu’aux Waffen SS… Mais, bien qu’il soit difficile d’y démêler l’imaginaire du réel, une réhabilitation du loup se manifeste avec les enfants-loups. Ce sont Romulus et Remus, fils adoptifs de la louve romaine ou plus récemment Mowgli de Kipling (‘Livre de la jungle’), sans oublier bien évidemment Kamala du révérend Singh. Baden-Powell crée de son coté le scoutisme avec ses louveteaux. ‘Walt Disney, en dessinant l’histoire des Trois Petits Cochons, a de manière saisissante et simpliste, retracé la dualité du loup dans l’imaginaire : à coté du Grand-Méchant-Loup rustre, ridicule, plus bête que cruel, il figure le fils, le si gentil P’tit Loup, serviable, délicat, intelligent, pétri de bon sens, ami des petits cochons, mais aussi rejeton affectueux envers son vieux père.’(p.348). Depuis Kipling peu exact dans ses descriptions animalières, les romans de James Olivier Curwood et de Jack London (avec son remarquable ‘Croc-Blanc’), puis de Farley Mowat, aujourd’hui d’Hélène Grimaud, de Jiang Rong, présentent des loups plus proches de la réalité et plus sympathiques (références en fin d’ouvrage). Des films comme ‘Danse avec les loups’ vont jusqu’à associer le massacre par la civilisation en marche des loups et des indiens. Ces œuvres d’imagination, qui réhabilitent le loup, sont basées sur les connaissances scientifiques qui se font de plus en plus précises sur cet animal secret et mystérieux, mais elles sont aussi en phase avec les préoccupations écologiques et éthiques de notre époque.
.